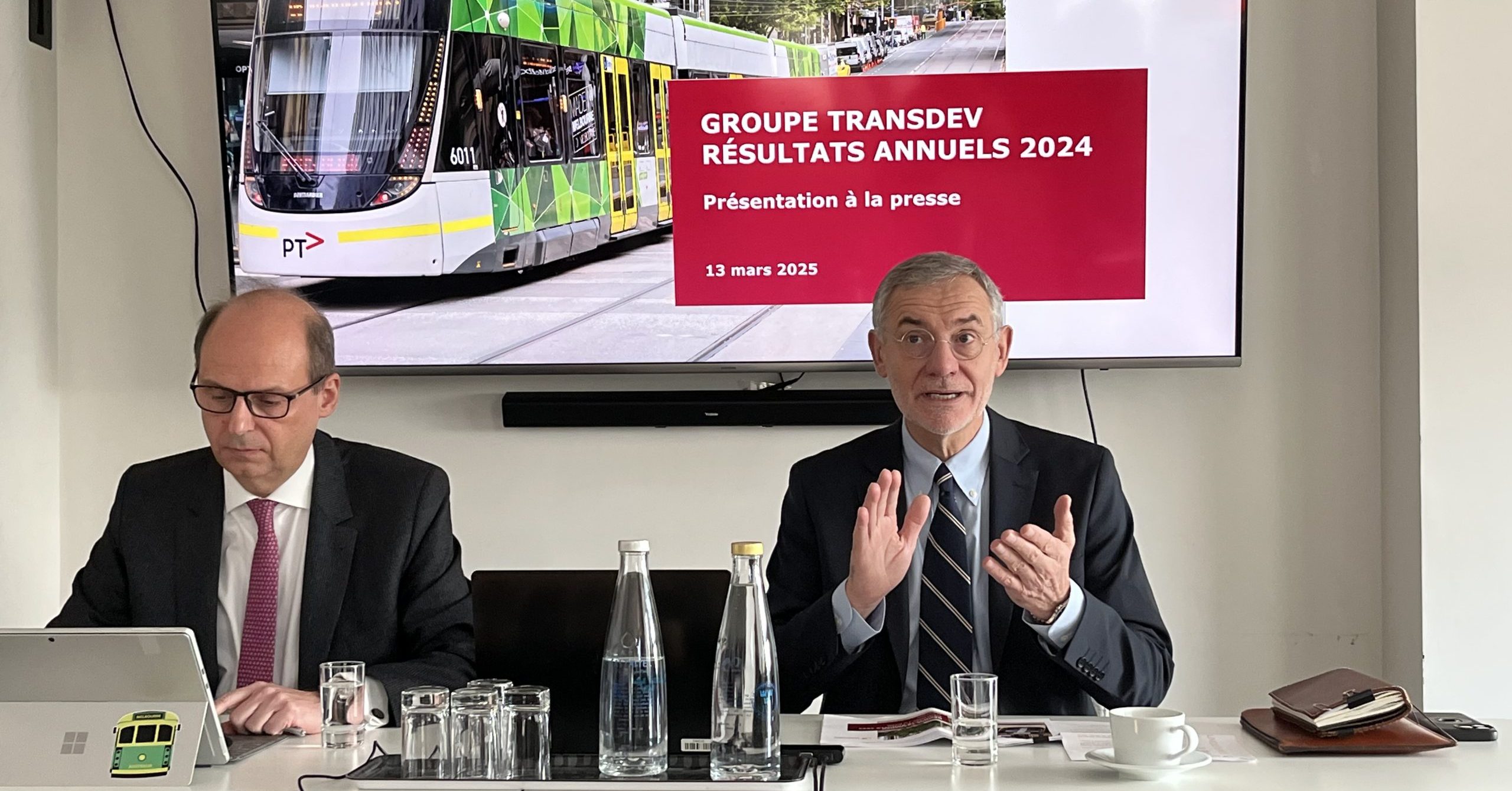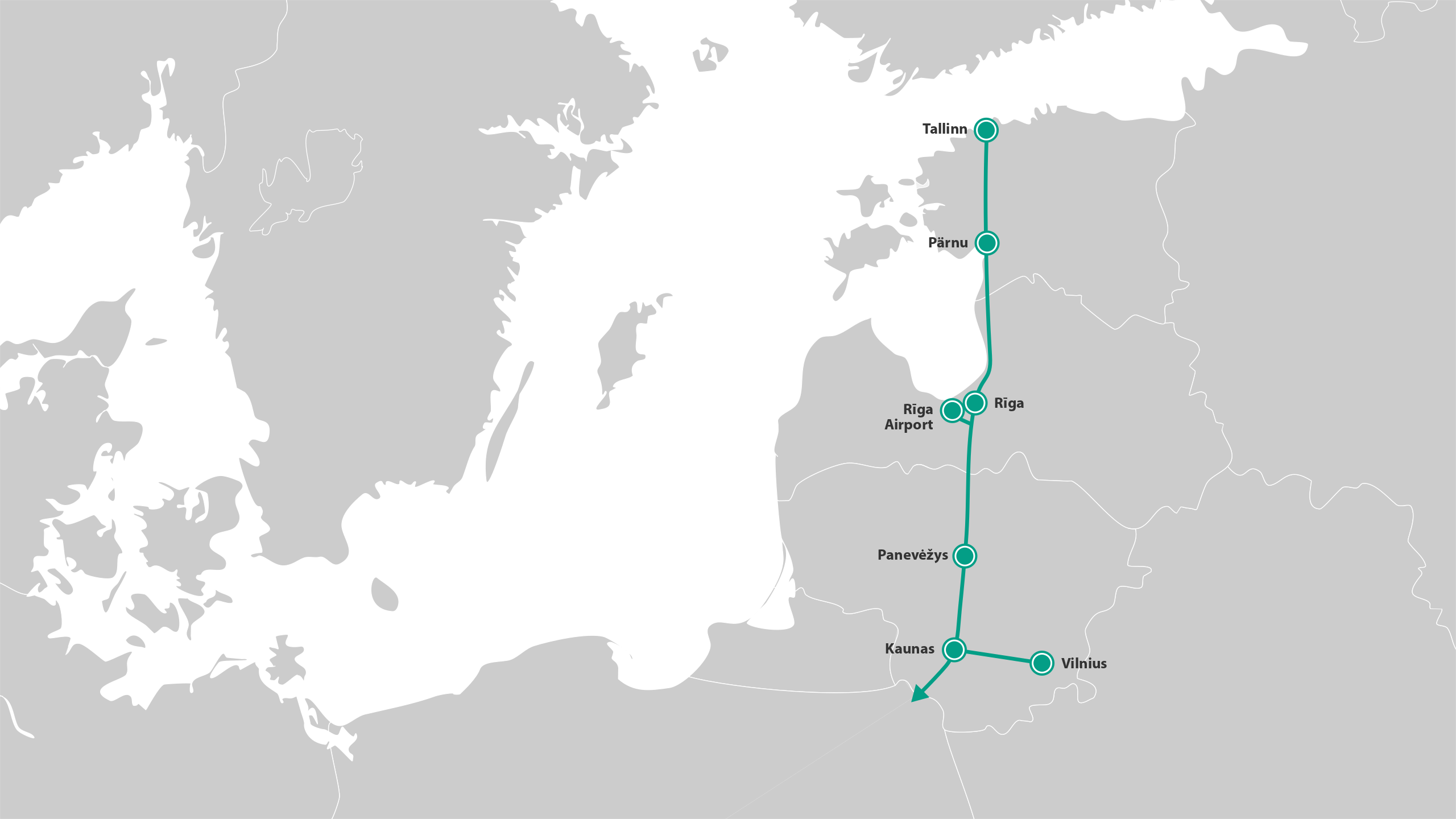Le rapport de la Cour des comptes publié le 23 octobre apporte un éclairage intéressant sur les modèles et les impacts de l’ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux chez nos voisins européens. Avec un focus sur la Suisse, la Suède et l’Allemagne.
En Suisse, un modèle très virtuel
On peut ouvrir son réseau ferroviaire à la concurrence et ne jamais voir pointer l’ombre d’un train de la concurrence. C’est le cas en Suisse où les chemins de fer fédéraux, les CFF, ne sont plus en situation de monopole depuis 1996 pour les trains régionaux, et où aucune nouvelle entreprise ferroviaire n’a encore fait son entrée (1). Les autorités organisatrices des transports régionaux sont ravies, l’objectif de la libéralisation était de challenger les CFF, l’opérateur historique, en utilisant la concurrence comme un aiguillon pour débourser moins d’argent public. Il s’agit en fait d’une ouverture « virtuelle », qualifie le rapport de la Cour des comptes, pour faire progresser l’ancien monopole et le rendre plus performant.
Opérateur sous pression
Depuis la libéralisation des services ferroviaires régionaux, les pouvoirs publics signent des contrats « coût net » avec les compagnies. Les CFF en l’occurrence puisque aucune autre entreprise ferroviaire n’a tenté sa chance sur le marché suisse. Ces contrats permettent aux collectivités locales de ne payer que pour les services convenus à l’avance pour un montant prédéfini. En cas de déficit, la collectivité locale ne le couvre pas, au transporteur ferroviaire d’assumer les risques de l’activité.