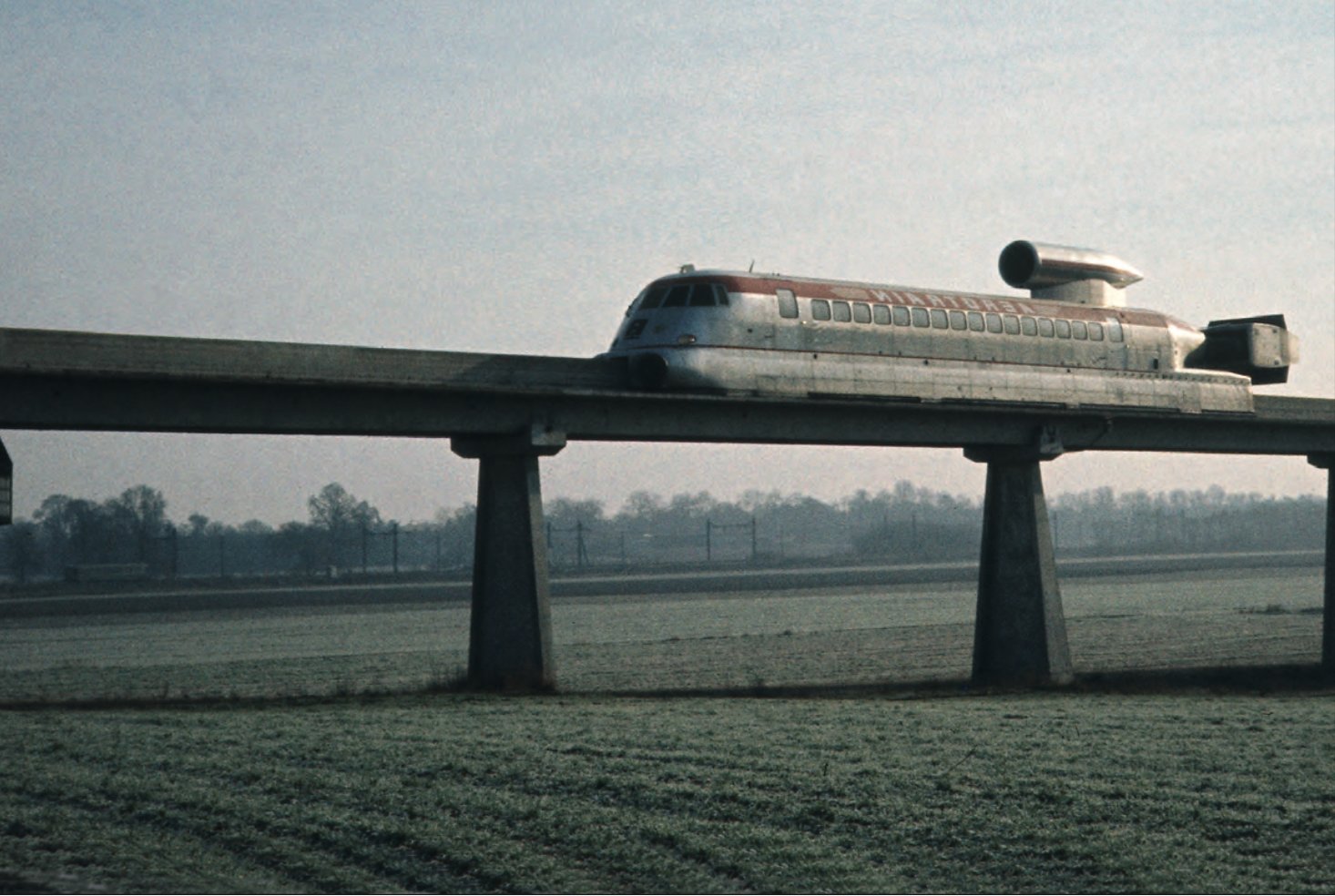Cette rubrique est animée par vous et pour vous. Elle vous permet de revisiter l’histoire cheminote. Celle d’il y a 10, 20, 30, 40 ans… Profitez de nos archives en nous signalant ce que vous souhaitez relire et redécouvrir. Une plongée dans l’aventure du rail.
Faites-nous savoir vos envies dès à présent en nous écrivant au 29, rue de Clichy, 75009 Paris ou par mail à : margaux.maynard@laviedurail.com
131) Entre Valence Marseille et Montpellier (cet article est tiré de nos archives, il date d’il y a 37 ans)
Les TGV gagnent encore du temps sur le temps
Depuis le 1er avril, les TGV Paris – Marseille et Montpellier sont autorisés à circuler à 200 km/h dans la vallée du Rhône et dans la plaine de la Crau, en cas de retard. Pour le service d’hiver, le 30 septembre, cette possibilité sera utilisée en service commercial, procurant des gains de temps respectifs de douze et six minutes sur les deux branches des « TGV-Midi ». Avant d’en arriver à ce résultat, d’importants travaux ont été nécessaires, tant sur la voie et sur les signaux que sur les caténaires et dans les sous-stations d’alimentation.
A partir du prochain service d’hiver, les TGV relieront Paris à Marseille en 4 heures 40 et Paris à Montpellier en 4 heures 41, soit des gains de temps respectifs de douze et six minu tes par rapport aux meilleures prestations anté rieures. Ce résultat a pu être obtenu grâce à la pratique commerciale du 200 km/h dans la vallée du Rhône et dans la Crau, mais également à la suite de la réduction des détentes incorporées dans les marches pour travaux. Son impact sera du plus haut intérêt car, en trois ans, la desserte Paris – Marseille, avant et après TGV, aura été améliorée de deux heures. au minimum, ce qui explique le succès – dépassant les espérances – des relations vers le midi de la France. Le gain clé quelques minutes, sur une infrastructure classique aussi chargée que l’artère Lyon – Marseille, aura été longue et onéreuse. Il aura fallu ainsi près de quatre années de travaux, exécutés dans des conditions difficiles. Globalement, l’investissement aura été de 103 millions de francs 1984 (passages à niveau exclus). Indépendamment des travaux sur la signalisation (voir article suivant), le relèvement de la vitesse-limite à 200 km/h a nécessité d’importantes retouches à la voie et aux installations de traction électrique, qu’il s’agisse de la caténaire ou des. sous-stations d’alimentation en 1″500 V continu.
Trois zones retenues
Cette réalisation vient donc compléter la liste des travaux ayant conduit à un relèvement substantiel de la vitesse sur les lignes anciennes de la SNCF »: Paris – Bordeaux, Orléans – Vierzon et Le Mans – Nantes. D’autres opérations du genre sont encore envisageables et pourraient être réalisées dans les années à venir. C’est le cas des sections Bordeaux – Morcenx (voir La Vie du Rail, n°1954), de Strasbourg – Mulhouse, de Saincaize – Saint- Germain-des-Fossés, voire d’Epernay – Revigny, sur Paris – Strasbourg.
De Lyon à Valence, l’artère Paris – Marseille se caractérise – il n’est pas inutile de le rappeler – par un tracé assez sinueux longeant le Rhône à distance variable. Ce tracé ne permet de pratiquer le 160 km/h que sur 22 % des 105 km du parcours. On y rencontre même trois points singuliers « : Vienne, Les Roches-de- Condrieu et Tain l’Hermitage, où des ralentissements à taux fixe, respectivement à 100 et 140 km/h sont prescrits.
De Valence à Avignon, gares où le passage sans arrêt n’est autorisé qu’à 90 km/h (1), la voie ferrée est établie dans la vaste plaine du fleuve. Son implantation est assez favorable, à l’exception de deux zones critiques!: l’une de 5 km entre Châteauneuf-du- Pape et Donzère, à la traversée du « robinet de Donzère », l’autre entre Bollène et Orange. Dans le premier cas, de multiples courbes et contre-courbes d’un rayon minimum de 658 m imposent un ralentissement à 150 km/h!; dans le second, le tracé est assez tortueux, avec notamment un passage difficile aux environs de Mornas où la vitesse s’abaisse à 140 km/h.
Etablie, d’Avignon à Tarascon, en lisière de la Montagnette, limite extrême des Alpilles l’ouest, l’artère Lyon – Marseille a ensuite, jusqu’à Miramas, un excellent tracé, d’abord dans le delta du Rhône jusqu’à Arles, puis dans l’étendue désertique de la Crau. Au-delà de Miramas, elle épouse les rives de l’étang de Berre, longe la chaîne de l’Estaque, puis pénètre dans l’agglomération marseillaise au débouché du long tunnel de la Nerthe. De ce fait, ce dernier trajet n’est pas très performant.
En résumé, quatre zones géographiques déjà partiellement autorisées à 160 km/h pouvaient, de par leurs caractéristiques et moyennant des travaux d’adaptation coûteux, voir leur vitesse relevée pour utiliser au maximum les possibili tés de traction des LGV. La longueur des parcours, pour être Intéressante, devant être au minimum de 20 km, en raison du temps d’accé lération et de freinage des engins, seuls ceux cités ci-après présentaient, en fait, des carac téristiques satisfaisantes !: de Valence sud à Châteauneuf- du-Rhône (52 km), de Donzère à Bollène (22 km), d’Orange au Pontet (25 km) et d’Avignon sud à l’entrée de Miramas (62 km).
Dès que la décision de réaliser le TGV Sud -Est, avec prolongement sur les itinéraires exis tants en direction du sud, a été prise, les études d’amélioration de ceux-ci ont été menées conjointement par les régions SNCF de Lyon et de Marseille. Trois sections, où les relèvements pouvaient être_obtenus moyennant un coût rai sonnable, ont été en définitive retenues à sa voir celles de Donzère (km 674,600) à Bollène (km 696,656), d’Orange (km 713,200) au Pontet (km 738,600) et de Tarascon nord (km 757,800) à Miramas (km 806,900).
Les travaux sur les autres sections ont été soit abandonnés (sortie d’Avignon à Tarascon), soit diffères (Valence – Châteauneuf). En effet, pour la première, nécessitant un investissement très lourd, le gain de temps aurait été inférieur à une minute. Il aurait fallu retoucher légèrement quatre courbes, comprises entre les km 749 et 754, remanier le plan de voies avec simplification et déplacement d’appareils en gare de Graveson et, surtout, riper les deux voies principales de 15 à 20 m dans la tranchée rocheuse de la Montagnette (du km 756,550 au km 757,800) où le rayon des courbes de sens contraire devait passer de 961 m à 1″518 m. P
our la section septentrionale, où les gains de temps pourraient être de l’ordre de deux ou trois minutes, le dossier sera revu ultérieurement, en fonction de sa rentabilité et de l’enveloppe budgétaire susceptible de lui être consacré. En dehors des travaux de signalisation, caténaires, adjonctions de sous-stations, deux points noirs concernant le tracé devraient être éliminés. Ce sont les courbes et contre-courbes de Blomart, au km 649 (980- 1″000 m de rayon), et celle du km 659 (1″000 m) qu’il faudrait porter à 1″500 m de rayon. Cette opération nécessiterait des acquisitions de terrains et des ripages assez importants.
Courbes retouchées, ouvrages d’art modifiés et PN supprimés
D’une manière générale, les 96 km de double voies retenus pour bénéficier des relèvements de la vitesse étaient déjà armés de longs rails soudés (LRS) depuis plusieurs années. L’adoption de la vitesse de 200 km/h a supposé la suppression, dans toute la mesure du possible, des appareils de dilatation, l’incorporation des appareils de voies aux barres longues, obtenue par soudage avec ceux-ci, et la révision de la géométrie de la voie avec augmentation du dévers de courbe par bourrage mécanique lourd. Le nombre de courbes à traiter a varié selon les zones géographiques. Ainsi, sur Donzère – Bollène, une seule courbe de 2″777 m de rayon a dû être reprise avec léger ripage, alors que sur Orange – Le Pontet, cinq courbes, de rayon compris entre 1389 et 1″857 m, ont été concernées. Il en a été de même à la fin de ce tronçon pour deux autres courbes de 1136 et 1190 m, incluses entre les km 736,5 et 737,4, ce qui n’a permis d’accorder qu’un relèvement à 170 km/h au lieu de 200, entre les km 734 et 738,6. Quant à la zone sud, Tarascon – Mira mas, qui comprend le deuxième plus long alignement de France, du km 780,4 au km 804,5, soit 24, 1 km, cinq courbes ont été rectifiées »: trois en amont de Tarascon, de rayon variable (1″613 à 3″333 m) »; une en aval d’Arles (1″429 m) et l’autre en aval d’Entressen (1″316 m).
La courbure de cette dernière imposera une limitation à 180 km/h, du km 804,584 au km 806,900. Notons par ailleurs que le nouveau dévers de la série de courbes précédant Taras con a rendu incompatible le maintien sur le site de la communication voie 1 – voie 2, composée d’appareils de tangente 0, 11, franchissables à 30 km/h. Elle a dû être déplacée et reportée 1″300 m plus au nord, en alignement, avec emploi d’appareils permettant le franchissement à 90 km/h et améliorant ainsi les conditions de sortie d’une voie unique temporaire (VUT) éventuelle (2). Deux autres contraintes ont dû également être levées. Elles concernaient »:
– la tenue de la plate-forme au niveau de la tranchée en courbe ds 1 500 m de La Batelle, qui s’étend du km 779,250 au km 779,900, point critique ayant motivé de nombreux ralentissements inopinés du fait ·de l’instabilité des terrains, avec création d’un réseau de drains, consolidations et un relèvement de voie atteignant près de 120 cm!;
– la pile 19 du grand viaduc en maçonnerie d’Arles, long de près d’un kilomètre, très nettement déversée, qu’il a fallu démolir et remplacer par un remblai de raccord.
Tous les travaux touchant la voie et la plate forme ont été exécutés de 1981 à 1983, le plus souvent en même temps que d’autres types d’opérations.
Nouvelles sous-stations et caténaire renforcé
Afin de satisfaire aux conditions requises pour la circulation des TGV à 200 km/h, il y avait lieu, dans un autre ordre d’idées, de procéder au· remplacement des tabliers métalliques de ponts-rails très anciens par des tabliers à poutrelles enrobées. Deux ouvrages étaient visés dans la zone nord, trois dans la zone médiane et quatre dans la zone sud. Tous avaient été substitués, au début de 1984, à l’exception de celui du km 762,386, en pleine ville de Tarascon ! : il le sera en septembre. Enfin, pour des questions de sécurité évidentes, on a éliminé systématiquement les derniers passages à niveau, en liaison avec les DDE de la Drôme, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Au total, trente-deux passages à niveau ont ainsi disparu sur les zones où la vitesse sera de 200 km/h, soit sept au nord, onze au centre et quatorze au sud, remplacés par des ponts-rails ou des ponts-route. La dernière suppression (PN 418 d’Orange) est intervenue au printemps.
La traction électrique 1!500 V est apparue à trois dates différentes sur Valence – Marseille!: les 23 juillet 1959, de Loriol à Avignon, 8 mai -.1960, d’Avignon à Tarascon, et 5 juillet 1960, de Tarascon à Miramas. Les installations caténaires, de « type renforcé », conçues à l’origine pour une vitesse-plafond de 140 km/h, sont utilisées à 160 km/h sans avoir subi de modifications. Elles doivent, par contre, être améliorées pour favoriser le captage du courant par les circulations à 200 km/h, les doubles rames TGV devant avoir leurs quatre pantographes levés. Divers enregistrements effectués sur les sections de ligne considérées ont révélé l’existence d’une contreflèche nécessitant une re prise de la tension du porteur principal. De plus, diverses améliorations ont dû être apportées, à savoir!: – modification des blocs de liaison feeder-porteur principal et le remplacement des connexions d’alimentation feeder- porteurs et fils de contact!;
– remplacement des bras de rappel existants par des bras de rappel allégés, en matière synthétique !; – remplacement des isolateurs type « papillon » par des isolateurs type « capot à semelle »!;
– reprise du pendulage par remplacement des pendules ronds, des pentes de raccordement aux ponts-route et passages à niveau, ainsi que de la tension du feeder dans certaines zones!;
– modification du réglage au niveau des appareils de voie!;
– reprise de la régularisation.
Tous ces aménagements ont dû être réalisés à la faveur de « blancs-circulation » ou ont parfois nécessité l’utilisation d’engins diesel pour la remorque des trains. Dans toute la mesure du possible, on les a jumelés avec d’autres opérations classiques de maintenance de la caténaire.
En ce qui concerne l’alimentation en énergie de traction, le tronçon Montélimar – Miramas, englobant les trois zones à 200 km/h, avait été doté initialement de neuf sous-stations espacées en moyenne de 16 à 19 km. Elles comprenaient chacune un groupe de 4!000 kW à excitrons compoundés monoanodiques, sauf celle de Champfleury, à Avignon, qui en possédait deux. Compte tenu de son vieillissement, de l’augmentation des puissances appelées par les locomotives et de là. croissance du trafic, le renouvellement de ce matériel a été réalisé au cours des années 70, avec mise en place de groupes redresseurs secs au silicium de 5!000 kW. De plus, un second groupe de ce type a été adjoint récemment à la sous-station de Miramas, dans le cadre de l’électrification du golfe de Fos. Même après cette modernisation, toute chute de tension en ligne n’était pas exclue, lors d’une concentration de trains circulant en batterie dans un intervalle compris entre deux sources d’alimentation successives et, a fortiori, en cas d’effacement programmé ou inopiné d’une sous-station. Du fait des performances élevées des TGV, notamment lors des montées en vitesse, et sur lesmation d’énergie devait s’accroître très sensiblement. Pour faciliter. l’exploitation future, il a été jugé indispensable de créer cinq nouvelles sous-stations intermédiaires, équipées d’un groupe de 5!000 kW, par analogie avec celles déjà en service. Celles de Montdragon (km 699), Le Pontet (km 733,8) et Mas Pointu (km 802,6) sont entrées en fonction courant 1983!; alors que celles de Crémadé (km 715) n’a été opérationnelle que le 9 août dernier. Quant à la dernière, construite à Ségonnaux (km 768,6), elle ne le sera qu’au printemps 1985.
Alors que la sous-station de Châteauneuf-du -Pape est rattachée au central sous-stations de Lyon, celui de Marseille télécommande toutes les autres, à partir de La Palud, en direction du sud. Dès l’entrée en vigueur du service d’été 1984, les portions de voie à 200 km/h étaient officiellement rendues aptes à être parcourues à cette vitesse par les seuls TGV, mais exclusivement en cas de retard. Ce n’est qu’au service d’hiver prochain que la mesure prendra son plein effet commercial, grâce à l’application des marches C 200, avec détente réglementaire de quatre minutes et demie aux 100 kilomètres sauf pour les TGV 803, 815, 821, 835, 808, 814 et 840, gratifiés exceptionnellement d’une dé tente réduite à trois minutes.
Il en résulte une mini-réforme horaire sur Lyon – Marseille, non seulement pour les TGV, mais aussi pour les autres rapides et express encadrants et les trains de marchandises RA et RO avec, pour ceux-ci, le cas échéant, décalage de sillons, voire changement de points de garage. Pour tirer pleinement parti de la mesure, le réseau Sud-Est a également supprimé les dé tentes pour travaux accordées depuis plusieurs services, les travaux importants qui les motivaient étant à présent achevés. Il a enfin modifié l’organisation du service des TGV, en donnant priorité, à Avignon, aux rames pour et de Marseille, à une exception près (834/884) (3).

Le train 5089 Lyon – Marseille, assuré par une automotrice Z2, franchit l’un des ponts construits pour remplacer les passages à niveau, au sud de Tarascon. © M. Carémantrant
L’accélération qui en découle donne, par rap port aux horaires de l’hiver 1983/1984, des gains de temps de sept à dix-huit minutes sur les relations Paris – Marseille, et une à huit minutes sur Montpellier. De même, le trajet Valence- Avignon (124,4 km) sera couvert en cinquante et une minutes, à 146,3 km/h de moyenne, et Avignon – Marseille (120,8 km) en cinquante minutes à 145 km/h. Elle sera, accompagnée d’un remodelage de la desserte tenant compte des observations faites au sujet de la physionomie des déplacements de la clientèle.
C’est ainsi que!:
– les TGV 807 et 870 marqueront un arrêt à Montélimar, de même que le 884, à la place du 838!;
– les 803,-840, 890 et 831 feront halte à Lyon -Part-Dieu, en plus du 854/804, qui s’y arrêtait depuis cet été!;
– le 825 du vendredi sera avancé de 15 h 05 à 13 h 55, à Paris, pour éviter des surcharges au 821, le 827 étant lui-même retardé à 15 h 40.
– Bien que cela ait été envisagé ces dernières années, il n’est pas question, pour le moment, de faire circuler à 200 km/h certains trains classiques de jour, généralement très lourds. Il faudrait, pour cela, prendre des mesures de sécurité supplémentaires, modifier des CC 6500, machines dont la capacité d’accélération n’égalerait pas de toute façon celle des TGV, d’où des gains infimes, compte tenu du tronçonnement des sections aptes à la vitesse maximale.
Après cette importante étape complémentaire d’amélioration des liaisons Paris – Midi, il faut maintenant s’attendre à une stabilisation de la situation pour de nombreuses années. Pour faire un nouveau bond en avant, la solution existe, et n’a rien d’utopique.
Ayant déjà été étudiée, elle consisterait à créer un prolongement de la ligne à grande vitesse (LGV) contournant Lyon par l’est et se soudant à l’artère Lyon- Marseille au nord de Valence. Cet itinéraire, qui éviterait totalement la zone tourmentée et surchargée Saint-Clair – Part – Dieu – Guillotière, utilisable seulement entre 60 et 95 km/h, pourrait permettre de gagner environ trente minutes sur le temps de quatre heures quarante applicable prochainement au par cours Paris – Marseille. Compte tenu de la mise en oeuvre prochaine du TGV-Atlantique et de l’intérêt suscité par celui du nord, au plan international, ce projet reste pour l’instant du domaine du grand avenir. Il n’en demeure pas moins que ses avantages indéniables ne manqueront pas de susciter l’intérêt, ce qui devrait logiquement lui permettre de se réaliser un jour.
Bernard COLLARDEY
(1) 100 km/h à Avignon, ultérieurement, après renouvellement des voies principales à quai.
(2) Il est bon d’indiquer qu’il est envisagé, en 1986, le renouvellement de la voie 2 entre Tarascon et Avignon, ce qui figera le tracé dans la zone de la Montagnette et ne permettra plus de relèvement de vitesse dans cette zone.
(3) Cela en raison des flux de trafic et du fait que les TGV Montpellier doivent observer un ralentissement à 100 km/h sur les aiguilles de la bifurcation de Tarascon-nord.
200 km/h en toute sécurité

Trois nouveaux signaux sur la ligne impériale : le tableau « P » mobile en position d’ouverture où l’on distingue la bande verticale discontinue (à gauche) ; le tableau « P » fixe et sa balise (en haut) et le signal de fin de zone à 200 km/h, TlV type • B • et pancarte « Km », avec balise (en bas).
Dès l’annonce de la desserte TGV vers Marseille et Montpellier, il avait été envisagé de tenir compte des performances du matériel roulant pour essayer de relever les vitesses limites pratiquées jusqu’alors. Après des études sur place, un train d’essais a circulé plusieurs fois à la fin du mois de mars 1983, entre Valence et Miramas, à des vitesses échelonnées de 160 à 200 km/h (voir La Vie du Rail, n° 1895, du 26 mai 1983).
Des travaux complémentaires ont alors été entrepris et, depuis le 1er avril 1984, le 200 km/h est autorisé dans la vallée du Rhône et dans la Crau.
Pour permettre une telle vitesse, un certain nombre de modifications ont été apportées, dont la reprise du dévers de la voie dans les courbes. Mais la plus grande partie des travaux a porté sur les installations de sécurité!: la totalité des passages à niveau a été supprimée par construction de passages supérieurs (ponts-route) ou inférieurs (ponts-rail). En effet, compte tenu du risque encouru par la présence d’un véhicule sur le passage à niveau, à l’approche d’une circulation ferroviaire roulant à 200 km/h, la réglementation actuelle impose la mise en place de dispositifs assez complexes, tels les détecteurs d’obstacles. Leur action est efficace dès que l’annonce se déclenche. En cas de présence d’un obstacle entre les barrières à ce moment-là, ils agissent directement sur la signalisation (fermeture des signaux).
En raison de leur coût élevé et d’un réglage délicat, on leur préfère, pour l’instant, la suppression pure et simple des passages à niveau. Notons qu’il en sera de même sur Le Mans – Nantes. Toutefois, entre Angers et Nantes, là où la ligne longe la Loire, un certain nombre de passages à niveau automatiques et gardés ont été maintenus. Normalement fermés à toute circulation routière, ils pourront être ouverts sous réserve d’une limitation à 160 km/h, lors que la Loire sera en crue, de façon à permettre une évacuation aisée des rivages.
La préannonce généralisée
Tous les panneaux de signalisation des zones autorisées à 200 km/h ont été équipés de la préannonce. Rappelons que ce système a été étudié afin d’utiliser au mieux les installations existantes, c’est-à-dire le block automatique lumineux (BAL). Au lieu de créer une signalisation spécifique complète, on a simplement ajouté une indication supplémentaire appelée « préannonce ». Présentée sous la forme d’un feu vert clignotant, elle commande au mécanicien d’un train autorisé à plus de 160 km/h de ramener sa vitesse à 160 km/h au maximum, lors du franchissement du signal fermé suivant!: les signaux ainsi préannoncés sont des signaux à distance tels que l’avertissement, le feu jaune clignotant et les ralentissements à 30 ou à 60 km/h. Dans ces conditions, le mécanicien retrouve les indications habituelles d’annonce d’arrêt ou de ralentissement auxquelles il peut réagir comme s’il s’agissait d’un train classique. Cette conception présente l’avantage suivant: on utilise les signaux existants implantés, en règle générale, pour 160 km/h. Les figures 1 et 2 reprennent la signalisation rencontrée par un mécanicien dans le cas de l’espacement des circulations.
Depuis le 6 février dernier, une modification de la réglementation impose, de plus, au mécanicien concerné de ramener sa vitesse à 160 km/h dès que possible et, de toute façon, avant le signal annonçant la fermeture du suivant. En outre, il doit observer cette vitesse de 160 km/h jusqu’au franchissement d’un feu vert de voie libre (indication fixe), et cela, jus qu’au dégagement de ce panneau par le dernier, véhicule de son train. Cette règle supplémentaire permet, dans certains cas, de ne plus utiliser les signaux de chantier pour une vitesse de 160 km/h.
Pour les limitations de vitesse annoncées par des tableaux indicateurs de vitesse (TIV), et non à partir des indications lumineuses, un signal spécifique est mis en place de façon à permettre au mécanicien de ramener sa vitesse à 160 km/h. li s’agit d’un tableau de forme carrée, présentant en noir sur fond blanc la lettre « P », initiale du mot préannonce. Suivant qu’il s’agit d’une limitation fixe, pour une courbe par exemple (voir figure 3), ou d’une limitation pour l’emprunt d’une voie déviée de bifurcation, ce tableau est fixe ou mobile. Dans le deuxième cas, il est donc soit présenté pour l’emprunt de la voie déviée, soit effacé. En position d’ouverture, il présente une bande blanche verticale discontinue (voir figure 4)!; la manoeuvre est réalisée par un moteur électrique fixé sur le mât.
La balise et le crocodile
Compte tenu de la vitesse pratiquée et des distances de freinage plus importantes, un nouveau système de répétition des signaux accompagne cette signalisation de préannonce. Chaque signal de la zone est équipé à la fois d’une balise et d’un crocodile. Le signal émis par la balise n’est perçu que par les trains autorisés à rouler à plus de 160 km/h. La répétition par balise fonctionne sans contact, seulement par effet d’induction électromagnétique entre la balise du signal répété et le capteur de l’engin moteur. Chaque engin équipé (CC 6500 du Sud -Ouest, 88 22200 de l’Ouest et TGV) possède deux capteurs dont un seul est en service, celui de gauche dans le sens de la marche. Au franchissement de la balise équipant le premier signal, la commutation se réalise automatiquement entre le crocodile et la balise. Le mécanicien contrôle cette action par l’allumage permanent dans sa cabine d’un voyant « B », à lettre noire sur fond blanc. Au franchissement d’un signal normalement répété par crocodile (voir La Vie du Rail, n° 1792, du 7 mai 1981 ), la balise transir.et les mêmes indications sonores de signal ouvert ou de signal fermé.

En cabine d’un TGV sur une section autorisée à 200 km/h. : le compteur indique 190 km/h et le voyant « B » est allumé. © M. Carémantrant
Pour les signaux de préannonce (feu vert clignotant ou tableau P), deux cas peuvent se rencontrer: si le signal n’est pas présenté, on a alors la répétition de voie libre!; si le signal est présenté, la répétition se manifeste par le son de signal fermé, spécialement modulé et accompagné de l’allumage clignotant d’un voyant « P », à lettre noire sur fond vert, sur le pupitre!; l’arrêt de la sonnerie est obtenu par action sur le bouton de vigilance. A cette répétition par balise, permettant de distinguer parfaitement un signal de préannonce d’un signal à distance, sont associés deux contrôles de vitesse. Dans les deux cas, le non-respect de cette consigne de vitesse déclenche le freinage d’urgence, avec allumage en cabine d’un voyant « URG », à lettres noires sur fond rouge.
Nous reviendrons prochainement en détail sur les aspects techniques de la préannonce.
Le personnel et les voyageurs
ne sont pas oubliés Outre ces modifications techniques, la sécurité du personnel et la protection des chantiers a également fait l’objet d’un certain nombre d’aménagements. Lorsque les agents d’entre tien sont amenés à travailler à moins de deux mètres du bord du rail (1,50 m pour des circulations TGV qui produisent un effet de souffle moins important), l’agent chargé de l’annonce des circulations doit avoir une, marge de visibilité d’au moins dix secondes, c’est-à-dire d’environ 560 m, à 200 km/h. Pour lui rappeler ces prescriptions, et compte tenu du fait que les zones à 200 km/h voisinent avec des zones à vitesse inférieure, les directions régionales de Marseille et de Lyon ont fait apposer des auto collants « Attention, vitesses supérieures à 160 km/h » sur tous les supports caténaires des zones concernées. Par ailleurs, certains travaux de voie, tels le soufflage ou le remplacement de traverses, nécessitent une limitation de vitesse à 160 km/h, notamment pour le passage du premier train. Contrairement aux réalisations précédentes de Paris – Bordeaux et Paris – Toulouse, l’adjonction d’un commutateur spécial va per mettre aux agents responsables de l’Equipe ment d’afficher le feu vert clignotant. Mis en place sur chaque panneau des zones à 200 km/h, ce commutateur, dénommé « commutateur 160 », a pour effet, lorsqu’il est manoeuvré, de présenter le feu vert clignotant sur le signal concerné.
Pour un chantier (voir figure 5), l’agent manoeuvre le commutateur du signal précédant le chantier. La vitesse devant être de 160 km/h sur toute sa longueur, le feu vert clignotant apparaîtra également sur le signal placé en amont. Si le signal situé après le chantier affiche le feu vert de voie libre, le mécanicien pourra reprendre sa vitesse maximale dès que l’en semble de son train aura dégagé le panneau et, par là même, le chantier.
Dernier point sur lequel a porté l’attention des responsables : la sécurité des voyageurs dans les gares traversées. Toutes ne sont pas, en effet, équipées d’un passage souterrain. Aussi, par mesure de sécurité, les passages planchéiés ont été munis d’un pictogramme semblable à celui des passages pour piétons équipés de feux routiers. Mais, petite différence : seule l’interdiction de traverser est donnée par l’allumage au rouge d’une figurine lorsqu’une circulation arrive ; en absence de train, le caisson est éteint.
Cet équipement a concerné trois gares : Sorgues, Le Pontet et Bédarrides. Sa mise en service n’a eu lieu que le 2 juin et l’exploitation à 200 km/h a donc connu une phase transitoire, du 1er avril au 2 juin, pendant laquelle la traversée de ces gares n’a été autorisée qu’à 160 km/h au maximum.
Après les deux lignes du Sud- Ouest, totalisant déjà environ 550 kilomètres équipés en préannonce, 96 kilomètres supplémentaires sont donc en service. A la fin septembre, les 100 kilomètres séparant Le Mans de Nantes viendront encore s’y ajouter. Et, lorsque le projet du TGV-Atlantique sera réalisé, la liste s’allongera encore, avec à nouveau un certain nombre d’innovations à la clef …
Marc CARÉMANTRANT