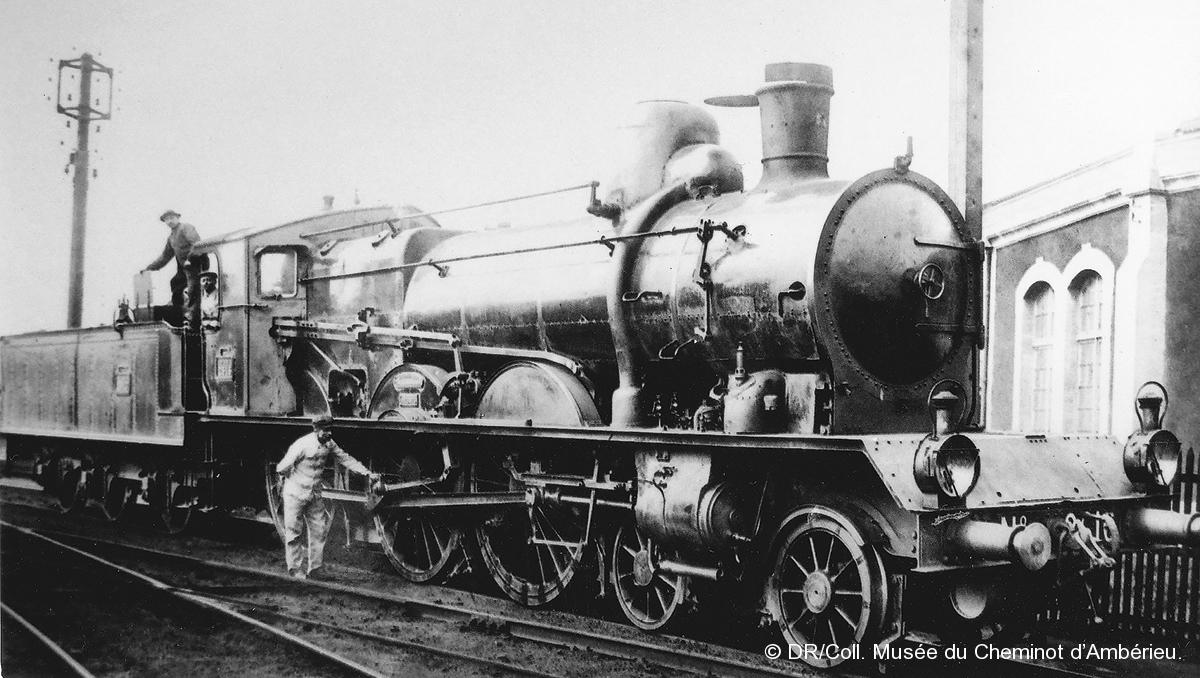Parue l’été 1942 dans de multiples journaux départementaux, telle « La Tribune de l’Yonne » du 17 juillet ou le « Cherbourg-Éclair » du 20 août, la SNCF diffuse une annonce assez surprenante, un appel renouvelé en faveur du développement de la culture du colza ou de la navette, brièvement argumenté : « Il faut aider nos transports ferroviaires », ou « Pour que nos trains puissent rouler. » Voilà qui mérite de s’intéresser à un sujet plutôt délaissé, l’histoire des lubrifiants ferroviaires…
1942 : un message de la SNCF diffusé dans la presse
« Pour faire face à la pénurie d’huile qui est une si grave menace pour les transports ferroviaires, la SNCF a adressé, en août 1941, un appel pressant aux agriculteurs, les invitant à reprendre la culture du colza et de la navette dont les grains produisent des huiles, grâce auxquelles nos trains pourront rouler encore. « Cet appel a été entendu : 5 000 hectares ont été ensemencés et la récolte, qui vient d’avoir lieu, va passer bientôt sous les presses des huileries. « Un tel effort fait le plus grand honneur à ceux qui l’ont entrepris ; ils ont eu le rare mérite de reprendre des cultures depuis longtemps abandonnées dans notre pays et que seuls certains d’entre eux se rappelaient avoir vu pratiquer par leur père. Ces pionniers ont d’ailleurs été récompensés : la récolte a été satisfaisante dans beaucoup de régions et la preuve est faite maintenant que le colza, comme la navette, semés de bonne époque et cultivés avec soin, peuvent réussir parfaitement sur notre sol. « Si méritoires que soient ces résultats, ils ne permettent cependant pas de faire face aux besoins impérieux du chemin de fer et la SNCF doit adresser aux agriculteurs un nouvel appel, plus pressant que jamais ; elle leur demande de développer très largement ces cultures que, bien souvent, ils n’ont fait l’an dernier, qu’expérimenter. « Aucun d’entre eux ne doit ignorer quelle lourde tâche incombe actuellement au chemin de fer qui, presque seul, assure la quasi-totalité des transports indispensables à la vie économique du pays. « À l’agriculteur, notamment, il apporte ses engrais, ses semences, ses machines, tandis qu’il emporte les récoltes de la ferme dans les grands centres de consommation, qui attendent de lui leur ravitaillement de chaque jour. C’est-à-dire que tout ralentissement des transports ferroviaires créerait, pour l’ensemble du pays, une situation désastreuse. Les agriculteurs ne voudront pas que la pénurie de lubrifiant, dont est menacée la SNCF, puisse avoir de pareilles conséquences. « Les pouvoirs publics se sont efforcés d’encourager les efforts des agriculteurs et ils ont prévu, en faveur de ceux qui souscriraient des contrats de culture de colza et de navette, des avantages plus considérables encore que précédemment. Ce sont d’abord des avantages en espèce ; le prix légal des graines de colza et de navette a été porté, pour la récolte de 1943, à 800 francs le quintal. Fixé, en principe, au double de celui du blé, ce prix reste encore susceptible d’augmentation, si le cours du blé vient à être relevé l’an prochain ; il s’y ajoute, pour les souscripteurs de contrats, une prime de 300 francs par quintal de graines livrées. C’est donc à 1 100 francs le quintal, au minimum, que seront payées les graines de colza ou de navette, fournies en exécution des contrats passés cette année. « Quant aux avantages en nature, ils comportent l’attribution, à titre onéreux, de 9 kilos d’huile de colza ou de navette par 100 kilos de graines livrées, ce qui ne fixe donc pas de limite maxima à cette attribution.
« Pour les petites cultures que cette formule aurait désavantagées, il pourra être accordé des quantités d’huile proportionnelles au nombre de personnes vivant sous le toit du cultivateur, jusqu’à concurrence du produit de la moitié de sa récolte.