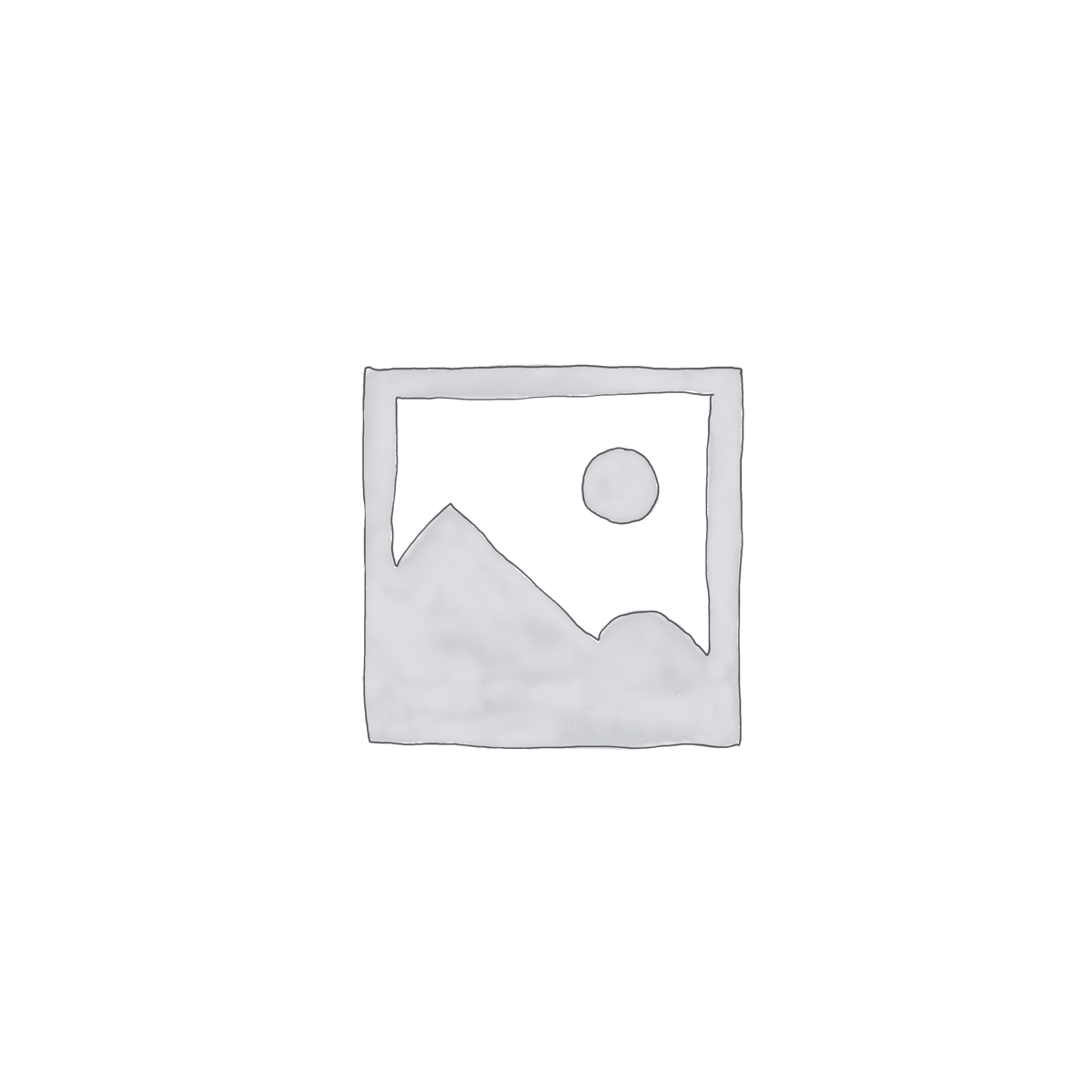« Il faut un cadre social homogène et compétitif »
Dans l’interview qu’il a accordée à La Vie du Rail,
le président de la SNCF plaide, en cette rentrée, pour une réforme de
l’ensemble du système ferroviaire européen permettant des conditions de
concurrence raisonnables. Au nom de l’efficacité, il défend un outil
public unifié, selon lui, plus économique et capable de soutenir
l’industrie. Il annonce aussi une SNCF décentralisée comme ce sera le
cas en Île-de-France dès 2013 et réclame plus de marge de manœuvre pour
les États au sein de l’Europe.
La Vie du Rail. La SNCF est
mise à mal par ses concurrents dans le fret, le fret ferroviaire est
mis à mal par la route et on se demande ce qui va se passer le jour où
les TER seront ouverts. N’avez-vous pas un problème de compétitivité ?
Guillaume Pepy. Si ! Être compétitif, c’est offrir le meilleur rapport
qualité-prix à tous nos clients – voyageurs, chargeurs, autorités
organisatrices – tout en obtenant les résultats financiers pour assurer
notre développement et investir. C’est donc global. Nous nous battons
constamment sur tous les fronts, pour tenir nos coûts, gagner en
productivité, innover et faire évoluer nos services. Gagner en
compétitivité : oui, mais à la loyale, et avec les mêmes règles pour
toute la branche ferroviaire. La comparaison avec d’autres opérateurs du
rail n’a de sens que si nous courons tous la même course. Quant à la
comparaison rail-route, le moins qu’on puisse dire c’est que le mode
ferroviaire part en Europe avec un lourd handicap.
LVDR. D’où votre lettre de juin à Jean-Marc Ayrault ?
G. P. Oui. J’ai écrit au gouvernement afin de l’alerter sur le fait que,
dans les conditions dans lesquelles s’est engagée la libéralisation du
marché ferroviaire, un cadre social à deux vitesses était en train de
s’installer en France, entre les règles d’organisation du travail
applicable aux cheminots SNCF (le RH0077) et aux autres cheminots (le
décret d’avril 2010). Comme président de SNCF, je ne peux pas
l’accepter, surtout lorsque l’on parle d’éléments contribuant à la sécurité et la continuité des circulations
ferroviaires : les conditions d’emploi, les amplitudes horaires, les
jours de repos et de congés. La concurrence ne peut pas être celle du
social : elle doit être celle de la qualité de service client et de la
performance ! L’annonce d’une réforme d’ensemble du système
ferroviaire confiée au ministre Frédéric Cuvillier et destinée à
promouvoir le mode ferroviaire et à le « remettre à l’endroit » est une
excellente nouvelle. Si la France ne reprenait pas l’initiative en
disant quel avenir elle veut pour ses activités ferroviaires, l’Europe
continuerait à décider pour elle.
LVDR. Selon votre plan d’affaires
2013-2017 cité par Les Échos, vous craignez une perte de marché de
l’ordre de 30 % dans le TER. Vous confirmez ?
G. P. Non ! Ces
projections avaient été établies au printemps dernier en tenant compte
de l’hypothèse, évoquée par le précédent gouvernement, d’une ouverture à
la concurrence des TET dès 2014 et des TER en 2015. Cette hypothèse
n’est plus d’actualité pour le gouvernement. Mais nous travaillons
d’arrache-pied pour permettre aux régions de développer les TER à un
coût raisonnable.
LVDR. Autre abandon, le rapport sur le cadre social commandé à Olivier Dutheillet de Lamothe…
G. P. Au contraire, il a mené une réflexion technique sur les scénarios
possibles pour la construction d’un cadre social harmonisé dans la
branche ferroviaire. Il a présenté fin juillet des conclusions aux
partenaires sociaux qui sont une sorte de « boîte à outils ». En
parallèle, le Conseil économique, social et environnemental a rendu un
rapport très complet, qui est public. Grâce à ces contributions, le
gouvernement dispose donc de matériaux pour un débat qui doit être
large, ouvert et contradictoire. Débat vital, car il s’agit ni plus ni
moins que de la construction du cadre social homogène d’une nouvelle
branche. Tout le monde s’accorde, je crois, pour qu’il soit protecteur
et compétitif.
LVDR. Mais le débat n’a-t-il pas déjà eu lieu, avec les Assises ?
G. P. Pas sur la question du volet social, pour un secteur élargi et
diversifié. Élargi, car le cadre concerne toutes les entreprises
ferroviaires. Diversifié, car il doit concerner aussi, à mon avis, les
activités de gestion du réseau, des gares et les fournisseurs de travaux
ferroviaires. Ce doit être un cadre social de qualité. Pour les
cheminots SNCF, cette démarche doit apporter deux garanties : d’une
part, pas de système social à deux vitesses qui nous exposerait à une
concurrence déloyale. D’autre part, un cadre propice au développement du
ferroviaire et des métiers de la mobilité. Je suis convaincu qu’un tel
cadre social, commun, protecteur et moderne, peut représenter une
conquête sociale.
LVDR. Le cadre peut-il être à la fois protecteur et propice au rail, quand le transport routier fait des gains de productivité ?
G. P. Oui, parce que la dérégulation routière va trouver sa limite. Elle
détruit les entreprises françaises au profit d’entreprises issues des
anciens pays de l’Est. Elle paupérise le secteur du transport routier et
déstabilise le ferroviaire. Le même sujet se pose partout : DB Schenker
Rail restructure, Renfe Mercancias est à vendre, SNCB Logistics doit
être recapitalisé et CFF Cargo est en difficulté. Il est urgent de
rétablir en Europe des conditions de concurrence intermodales
raisonnables !
LVDR. Comment conciliez-vous votre recherche d’un cadre protecteur pour les cheminots et vos intérêts de groupe routier ?
G. P. Attention à ne pas confondre nos activités de messagerie, qui
n’entrent pas en concurrence avec le rail et dans lesquelles nous sommes
n° 1 en France, avec les activités routières de « lot complet ».
LVDR. La convention collective fret n’a pas été signée, c’est la table rase ?
G. P. Il y a eu un gros travail de fait. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour conclure une convention collective, il nous faut un cadrage de l’État et des règles applicables à tous. C’est le sens de mon courrier au gouvernement. Je
suis confiant. Cela a fonctionné en Allemagne, aux Pays-Bas ou en
France, dans l’énergie. En Allemagne, cela a pris quelques années mais,
aujourd’hui, le ferroviaire a un cadre commun où la différence de
salaire entre l’entreprise historique et ses compétiteurs est plafonnée à 6,5 %. L’Allemagne a le premier acteur ferroviaire mondial – la DB – et est le pays où la concurrence est la plus vive.
LVDR. Un recours plus large à l’autocar ne permettrait-il pas de faire baisser la facture du transport régional ?
G. P. C’est aux régions de décider. Elles ont formidablement développé le
rail : depuis 2002, l’offre TER a augmenté de 50 % et la fréquentation
de plus de 60 %. Elles n’hésitent pas à investir dans les
infrastructures pour aller encore plus loin, notamment dans les grandes agglomérations. Les
régions ont aujourd’hui une contrainte financière terrible. Elles ne
peuvent développer le service public de transport qu’à un coût
raisonnable pour les contribuables. Nous devons impérativement les aider
à maîtriser leur budget transport en limitant l’évolution de nos coûts et en leur donnant les moyens de choisir le meilleur rapport qualité-coût. SNCF est aussi prête à promouvoir des alternatives comme le transport à la demande, pour faire revenir le transport public dans des quartiers ou des régions mal desservis.
LVDR. Ne s’achemine-t-on pas naturellement vers des filiales de transport régionales ?
G. P. Non ! Dans le transport régional, nous expérimentons une SNCF plus
proche des élus, du terrain et des voyageurs. Si nous sommes réactifs et
plus responsables, les régions nous feront davantage confiance. Elles
seront moins tentées par les concurrents le moment venu. En Bretagne et
en Limousin cette année, en Île-de-France en 2013, nous mettons en place
cette SNCF décentralisée. Il n’est pas question de morceler l’Epic.
L’entreprise est capable de s’adapter et d’innover : regardez les initiatives
de TGV Éco, de fret d’avenir ou le renouveau des gares. Tous ces
projets ont été imaginés et développés par et dans l’Epic. Regardez
les transports urbains. Il n’y a pas plus lyonnais que les TCL, pourtant
c’est Keolis. Transpole c’est lillois et Keolis. Dans l’urbain,
l’identité est à la fois locale et nationale. Nous devons nous organiser
radicalement pour tenir les engagements des contrats TER et Transilien.
Cela n’implique pas de changement juridique. Mais il faut que les
responsables opérationnels aient tous les leviers.
LVDR. C’est-à-dire ?
G. P. Un directeur TER doit pouvoir, s’il l’estime nécessaire, recruter,
ajuster l’organisation des équipes, proposer de passer à une
organisation de week-end à l’atelier de maintenance, sans demander
d’autorisation aux directions centrales ! On simplifie, on abaisse le
centre de gravité et on fait des économies de frais de structures.
LVDR. Oui, mais si on s’achemine vers des contrats moins strictement ferroviaires et plus multimodaux, pas sûr que l’Epic soit le mieux placé pour y répondre…
G. P. Soyons complémentaires plus que concurrents ! À partir du cœur de
métier ferroviaire porté par l’Epic, les branches SNCF sont multimodales
: Proximités, Voyages, Gares & Connexions. On peut imaginer qu’une
future convention combinera l’offre ferroviaire de l’Epic SNCF, une
offre de bus de Keolis et la partie multimodale d’Effia.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la montée au capital de Keolis.
LVDR. Les régions ont beaucoup investi dans le TER mais on se demande parfois
si on n’est pas à la fin d’un cycle. L’époque qui s’ouvre n’est-elle
pas celle de la multimodalité ?
G. P. Oui… et non ! Oui, car pour le
service public ferroviaire, après le « toujours plus », il faut passer
au « toujours mieux ». Sans tabou. Dans certains territoires peu denses,
on peut proposer un mixte de bus et de train selon les heures et les
jours, avec du transport à la demande et du taxi collectif, ce qui fait
de l’emploi local. Il y a toute une palette disponible pour faire plus
de service public moins cher. Non, car il y a aussi des territoires
dans lesquels il faut répondre efficacement à l’explosion de la demande
des navetteurs quotidiens par plus de trains : Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, l’Île-de-France, l’agglomération de Bordeaux…
LVDR. Selon les options, repli ou développement, les conséquences sur
l’industrie ferroviaire ne sont pas les mêmes. Où va-t-on ?
G. P. Il
n’est pas question de repli ! Les régions ont dépensé plus de 7
milliards d’euros en matériel en 10 ans. Le réseau se modernise y
compris sur les petites lignes, avec les plans Rail Midi-Pyrénées,
Auvergne… et des nouveaux services sont créés, même pendant la crise. Et
la demande suit !
L’industrie ferroviaire est l’une des principales
forces de la France à l’exportation. SNCF en est un chef de file, en
tant que développeur et premier client. Les investissements en trains
neufs n’ont jamais été aussi importants que ces dernières années. Avec
notamment l’acquisition des Régiolis et des Regio 2N. À partir de 2013,
et pendant les trois prochaines années, nous accélérons le rythme de ces
investissements. Cela représente 1,4 milliard d’euros d’investissement
en 2013, soit + 47 % par rapport à 2012. Ma priorité est et reste celle
des trains du quotidien. Dès l’année prochaine, trois trains sur quatre
achetés rouleront en Île-de-France ou en région. Avec Jean-Paul Huchon,
nous attendons pour 2013 une trentaine de nouvelles rames Francilien. Avec
le ministre des Transports, nous restons très attentifs à la situation
industrielle de chaque fournisseur. Et je veille à ce que SNCF joue
pleinement son rôle vis-à-vis des sous traitants dans ces temps
difficiles.
LVDR. S’agissant de Régiolis et de Regio 2N, entre le programme total, environ 1 800 rames, et les commandes passées, quelque 300, il y a un gouffre.
G. P. C’est vrai… aujourd’hui, je ne connais pas de matériel ferroviaire
qui ne soit pas allé à la totalité du marché. La Z TER est allée au
bout, comme le TER 2N ou l’AGC ! Les régions ont acheté 700 AGC !
Je suis persuadé que pour le Régiolis et le Regio 2N ce sera le cas,
pour le trafic régional, et peut-être – qui sait ? – pour les
InterCités.
LVDR. Le système d’opérateur pivot que vous défendez permet-il vraiment une meilleure efficacité ?
G. P. Je le propose justement pour cela ! Rassembler infrastructure et
exploitation au sein d’un outil public unifié présente trois avantages
déterminants. D’abord, une meilleure qualité de service et une
exploitation plus efficace au quotidien, surtout en zone dense, dans les
grands nœuds et sur les LGV. En période de pointe, en Île-de-France, il
nous faut réagir en quelques secondes au moindre incident, ce qui a des
conséquences immédiates pour des milliers de voyageurs. Lorsque tous
les acteurs ne travaillent pas ensemble sous une même autorité
opérationnelle, le système patine et le client en subit les
conséquences.
En second lieu, pour la maintenance et l’entretien du
réseau, cela facilite les arbitrages à prendre entre travaux et
circulations, entre travaux de jour et travaux de nuit, péages et coûts
de maintenance du réseau. On ne peut pas faire remonter à l’État
le fonctionnement du système au quotidien, sous prétexte que les
acteurs ne sont pas en mesure de prendre des décisions !
Enfin, il
représente une simplification drastique pour les élus confrontés à un
ping-pong sur le foncier, les gares, les projets et les travaux… au total, cette simplification permettra des économies substantielles. Plus
largement, regrouper nos moyens et nos compétences au sein d’un pôle
public fort, c’est une garantie pour l’avenir industriel de la filière, notamment
à l’exportation. Regardez, que reste-t-il de l’industrie ferroviaire
britannique aujourd’hui ? Un opérateur de référence, ayant une vision
système, est une condition à la poursuite de l’innovation. Si tous
les experts infra, matériel, exploitation de SNCF n’avaient pas
travaillé ensemble, nous n’aurions jamais inventé le TGV. Des ruptures
aussi fortes que le TGV sont possibles, mais pour cela l’intégration est
impérative.
LVDR. Est-elle en bonne voie ?
G. P. Le Premier ministre a confirmé, dans son discours de politique générale, qu’il engagerait la réforme du système ferroviaire
et il en a confié la responsabilité à Frédéric Cuvillier, ministre des
Transports. Laissons-leur le temps de travailler.
LVDR. La
réforme ferroviaire dépend de la décision de la Cour européenne de
justice sur l’Allemagne, de la discussion sur le quatrième paquet
ferroviaire. C’est bien enchevêtré…
G. P. Les règles, ce sont aux
politiques de les faire. Le calendrier européen des prochains mois va
être très chargé. L’organisation du marché ferroviaire européen, c’est
d’abord un choix ouvert sur lequel les États, et notamment la France,
sont décideurs avec le Parlement européen. Il ne faut pas se tromper
de combat : la Commission veut un marché ferroviaire dynamique, plus
intégré et ouvert. Cela passe par un régulateur européen, par un vrai
pouvoir à l’ERA en matière de sécurité, par un financement sain des
infrastructures, par des garanties sur les conditions d’accès des
différents opérateurs aux réseaux et aux infrastructures de service. Sur
leur choix d’organisation, et sous réserve de non-discrimination, je
crois que les États doivent pouvoir conserver une vraie marge de
manœuvre. Je suggère à la Commission : soyez exigeants sur les finalités
et laissez un peu de subsidiarité sur les fonctionnements et les
structures, sinon vous allez tuer le rail en Europe.
©Jean-François Robert/SNCF Connections