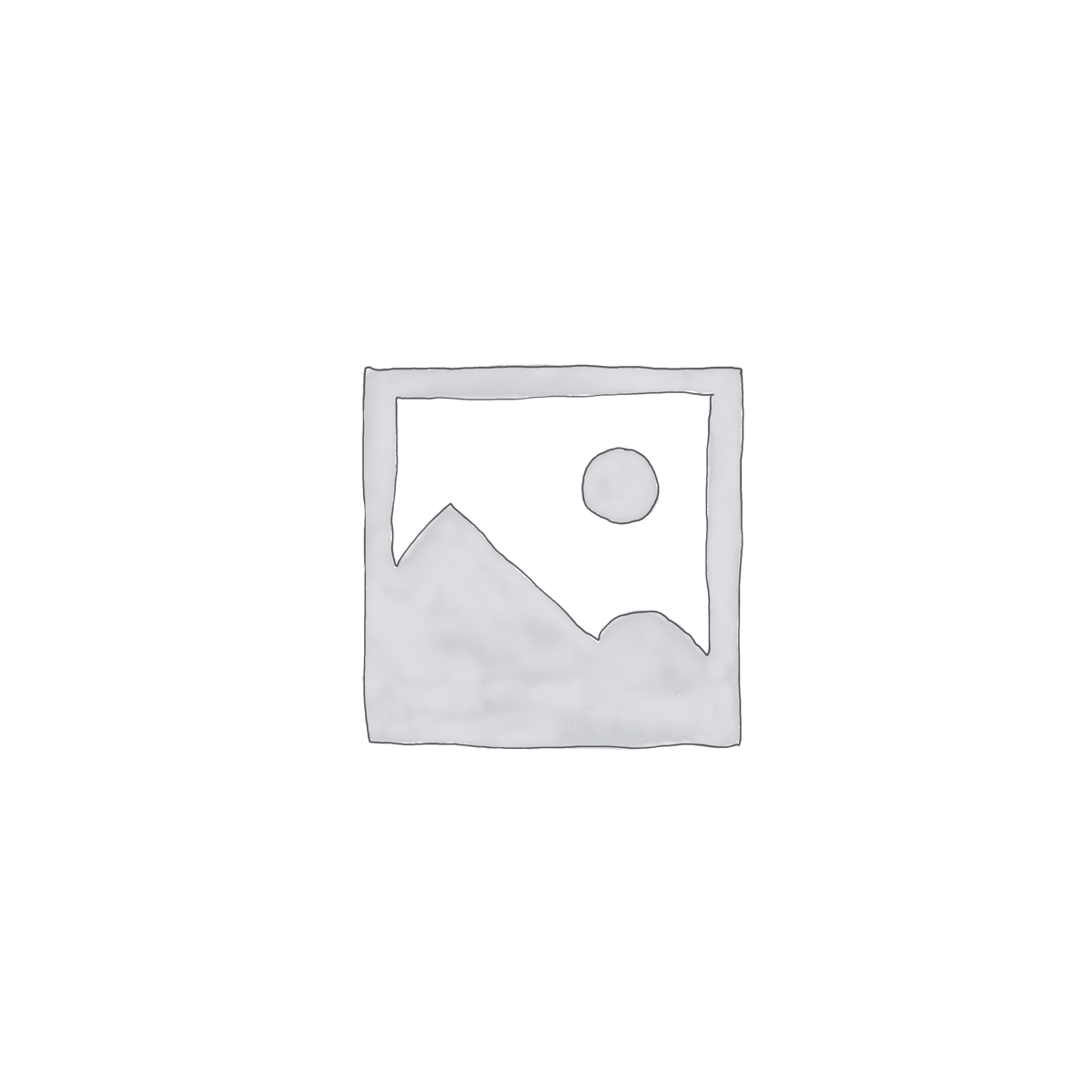Après la publication, le 18 mai, de la version définitive du rapport Grignon, le Conseil économique, social et environnemental organise, le 16 juin à Paris, un grand colloque sur l’ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire régional. Ville, Rail & Transports a demandé aux acteurs ferroviaires de réagir aux propositions du rapport Grignon sur les conditions d’expérimentation de la concurrence en France : la SNCF, bien sûr, et ses concurrents potentiels, Veolia Transport, Deutsche Bahn, ainsi que l’Afra (Association française du rail). Les opérateurs ferroviaires se félicitent de la publication de ce rapport, qui marque, selon eux, une étape importante. Mais la Deutsche Bahn critique certaines préconisations, tandis que les opérateurs français attendent maintenant l’ouverture de discussions pour aller au-delà. Reste à connaître la position du gouvernement et le calendrier qu’il souhaite fixer pour expérimenter la concurrence dans les TER.
Jean-Pierre Farandou, directeur général de SNCF Proximités :
« Il faut construire un système à la française »
Ville, Rail & Transports. Quel jugement portez-vous sur le rapport Grignon ?
Jean-Pierre Farandou. C’est un rapport très complet. Le sénateur Grignon a cherché à trouver un point d’équilibre entre les nouveaux entrants, les opérateurs historiques, les autorités organisatrices des transports… A partir de ce rapport, qui selon moi fera date, les discussions vont pouvoir être menées.
Je ne rentre pas dans le débat de savoir s’il faut ouvrir ou non le TER à la concurrence. La position des dirigeants de la SNCF est qu’on ne peut pas prendre le risque de dire que la concurrence ne viendra jamais. D’autant qu’elle existe déjà pour le fret ferroviaire et pour le transport international de voyageur.
Nous sommes dans une logique de préparation. A la question : quand viendra la concurrence ? C’est aux politiques d’y répondre. A la question : comment ? La SNCF a son mot à dire. Cette question conduit à un sujet central, celui de l’équité. La concurrence est acceptable dès lors qu’elle est équitable pour la SNCF. Il est aussi question de méthode et de progressivité. Il faudra du temps, de la concertation, du dialogue pour avancer. La SNCF, qui veut être acteur dans ces discussions, n’a pas à rougir de ce qu’elle a fait depuis dix ans : le TER s’est développé de 40 % sur cette période. Les autres pays européens n’ont pas fait mieux. La SNCF a su accompagner ce développement du point de vue qualitatif : depuis le début de l’année, le taux de régularité atteint 92 % en moyenne. La perspective de concurrence n’apparaît pas comme une sanction pour la SNCF.
VR&T. Le rapport a pris en compte les arguments de la SNCF demandant l’alignement des conditions de travail. Etes-vous satisfait ?
J.-P. F. Dans l’hypothèse de la concurrence, l’objectif de la SNCF est de perdre le moins possible de parts de marché. Pour cela, il faut aligner les conditions de travail de tous, salariés du privé et cheminots. Nous sommes fermes sur ce sujet car les coûts salariaux sont importants : ils représentent 60 % des coûts de production du service. L’amplitude horaire, les repos, les pauses… nécessitent un socle social harmonisé. Nous ne demandons pas pour autant l’application du RH0077 qui date de 1999. Il peut évoluer dès lors que l’on garde des règles sociales de bon niveau puisqu’elles concernent le service public avec de fortes exigences de sécurité. En termes de méthode, on peut partir de ce qui existe et voir quelles évolutions seraient possibles.
VR&T. Vous souhaitiez que le transfert automatique de personnel soit retenu. Pourquoi ?
J.-P. F. C’est ce qui se passe dans le transport public urbain. Mais je comprends que cette idée puisse préoccuper un cheminot qui pensait faire toute sa carrière à la SNCF. Le rapport retient le transfert sur la base du volontariat. Les cheminots qui refuseraient de changer d’employeur se retrouveraient dans une logique de reclassement qui implique une mobilité géographique. C’est une contrainte très lourde car elle implique un déménagement avec de multiples conséquences sur l’emploi du conjoint, l’école des enfants… Le transfert se ferait en conservant les éléments essentiels du statut de cheminot, comme la garantie de l’emploi et la possibilité de cotiser à la caisse de prévoyance…
VR&T. L’accès aux ateliers de maintenance de la SNCF vous paraît-il réalisable ?
J.-P. F. Pour les ateliers de maintenance, certaines règles sont fixées au niveau européen : au nom des facilités essentielles, les opérateurs doivent avoir accès aux installations fixes comme les stations-service par exemple. Mais d’un point de vue opérationnel, il ne sera pas si simple d’accueillir deux entreprises dans nos ateliers. Dans ce domaine comme dans d’autres, il faudra regarder comment concilier la réglementation avec la réalité opérationnelle.
Le rapport s’est placé dans une logique d’expérimentation. Il faudra donc aussi se poser la question : comment passer d’une expérimentation à la généralisation ? On peut comprendre que dans une logique où il faut aller vite pour lancer l’expérimentation, l’accès à nos installations soit demandé. Mais un par un, ces sujets mériteront d’être discutés par la suite.
VR&T. La direction du Matériel n’a-t-elle pas récemment indiqué qu’elle souhaitait développer son activité en proposant des prestations à d’autres opérateurs que la SNCF ?
J.-P. F. La direction du matériel peut effectivement dire que si la SNCF perd un marché, elle peut essayer de récupérer la maintenance du nouvel opérateur. Mais cet opérateur aura aussi son mot à dire, de même que l’autorité organisatrice des transports.
VR&T. Pensez-vous que les discussions vont pouvoir se poursuivre rapidement ? Sous quelle forme ?
J.-P. F. Je suis heureux d’avoir entendu le secrétaire d’Etat aux Transports dire qu’il faut continuer à discuter. Nous sommes favorables à un tel processus car les sujets sont complexes. Il faudra beaucoup de pédagogie et bien vérifier que l’on met les mêmes contenus derrière les mêmes mots. Mais il est trop tôt pour entrer dans les négociations. Le monde de la SNCF a besoin de comprendre ce qu’est une convention collective, et inversement le monde du droit privé doit comprendre le monde de la SNCF. Il faut construire un système à la française. L’Etat en fixera le cap.
VR&T. Ne pensez-vous pas que vous partez avec un handicap lié à vos coûts ? Une récente étude estimait à 30 % les surcoûts de la SNCF face à d’autres concurrents potentiels comme la DB par exemple.
J.-P. F. Il faut faire attention avec ce chiffre : il compare des carottes et des choux. L’étude fait une comparaison avec l’Allemagne où la durée légale du travail est de 41 heures contre 35 heures en France. De plus, le réseau allemand est dense, les conducteurs ont peu de temps morts. En France, les villes de province ne sont pas reliées par train tous les quarts d’heure. Il arrive que des conducteurs ne soient pas utilisés pendant deux heures. Ce n’est pas de leur faute ! L’histoire du pays nous a légué un système qui a prouvé son efficacité.
VR&T. Les régions se plaignent généralement de ne pas disposer d’une bonne maîtrise de leurs TER, notamment à cause d’un manque de clarté sur les coûts. Que leur répondez-vous ?
J.-P. F. Les régions nous disent aujourd’hui que le sujet immédiat n’est pas la concurrence. Elles demandent davantage de transparence. Je suis d’accord. Nous avons engagé un travail avec l’ARF [Association des régions de France, ndlr] sur la transparence de nos coûts. Nous savons que les régions se heurtent actuellement à des difficultés financières. Nous regardons comment ajuster nos coûts. Le sujet de la productivité n’est pas tabou. Nous en discutons avec les organisations syndicales. Chaque année, nous gagnons en productivité. Les conducteurs par exemple effectuent aujourd’hui plus de kilomètres qu’il y a quelques années. Il y a aussi une dimension organisationnelle. Certaines régions souhaitent une SNCF plus régionale, plus relationnelle. Nous y travaillons. Les régions cherchent à disposer d’une compétence globale sur la mobilité sur leur territoire au sens large du terme. Ce qui pousse à une meilleure complémentarité entre les modes. Il faut déterminer quel modèle contractuel choisir avec l’opérateur, soit une délégation du service public, soit une régie intéressée. Quand on choisit un modèle, il faut être cohérent car c’est cela qui détermine les questions de la prise du risque et de sa rémunération. Toutes ces thématiques sont devant nous.
VR&T. En privé, certaines régions expriment leur volonté de recourir à la concurrence. Comment réagissez-vous ?
J.-P. F. Si une région venait me dire qu’elle veut recourir à un autre opérateur, j’essaierais de comprendre ses motivations. Est-elle insatisfaite ? Est-ce une question économique ? Est-ce un problème relationnel ? Il est important de comprendre pour essayer de corriger ce qui peut l’être. Le TER est une activité importante pour la SNCF : il représente un chiffre d’affaires annuel de 4 milliards d’euros, 25 000 emplois répartis partout sur le territoire. C’est notre ADN. On est au cœur du transport public territorial. Il est évident qu’on a envie de se battre pour le conserver. Sans oublier que c’est un savoir-faire que l’on peut aussi exporter.
Propos recueillis par Marie-Hélène POINGT et Guillaume LEBORGNE
Francis Grass, directeur général de Veolia Transport :
« Ce modèle va permettre une meilleure transparence financière »
Ville, Rail & Transports. Comment réagissez-vous à la publication du rapport Grignon ?
Francis Grass. C’est un cap important et positif. Nous avons le sentiment que le sénateur Francis Grignon a écouté toutes les parties prenantes. Son rapport ouvre ainsi la voie à un processus d’ouverture qui prendra forcément du temps.
Il contient diverses préconisations intéressantes, parmi lesquelles le recours à la délégation de service public. La DSP renforce les prérogatives des régions : en tant qu’autorités organisatrices, celles-ci peuvent spécifier leurs exigences dans un cahier des charges puis comparer les propositions en termes de prestations comme de prix. C’est un modèle qui permet une meilleure transparence financière et qui contribue à tirer vers le haut la qualité commerciale.
VR&T. Le rapport retient le principe du transfert des personnels SNCF, auquel Veolia Transport n’était pas favorable. Que souhaitez-vous pour les négociations à venir ?
F. G. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter des aspects sociaux. Nous restons a priori réservés sur le transfert forcé des personnels SNCF mais le fait que le rapport Grignon retienne un principe de volontariat est positif. Cela dit, il reste encore des questions à régler. Qui sera transféré ? sachant qu’à la SNCF les agents travaillent souvent pour plusieurs activités : TER, TGV, trains d’équilibre du territoire… D’où l’intérêt de l’expérimentation qui permettra de regarder plus précisément les différents cas de figure. Dans quelques années, lors du renouvellement des contrats le traitement de ces questions sera naturel, comme cela l’est maintenant dans le transport public urbain. Aujourd’hui, lorsqu’un nouvel opérateur reprend un contrat, il reprend les personnels sans que cela pose de questions.
VR&T. Etes-vous favorable à l’application d’une convention collective pour tous, cheminots de la SNCF et du privé, qui reste à négocier ?
F. G. Nous sommes favorables au dialogue et à la négociation avec l’ensemble des partenaires sociaux qui permettra d’avoir un cadre cohérent. Mais il ne s’agit pas de notre point de vue, de généraliser les règles en vigueur à la SNCF en prenant le RH0077 comme base de la négociation. Pour autant, cette future convention collective ne devra pas être a minima, mais adaptée aux besoins de qualité et d’efficacité du service public. Rien n’empêche chaque exploitant de compléter ces dispositions conventionnelles par des accords d’entreprise. Un tel processus de discussion a déjà été mené à bien pour le fret. Tout cela, la fixation du cadre des négociations et ensuite les discussions, doit naturellement se faire dans le cadre des organisations professionnelles, c’est-à-dire de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP). Nous sommes prêts à nous investir rapidement dans ce dialogue indispensable.
VR&T. Que vous inspire votre expérience en Allemagne, notamment du point de vue social ?
F. G. Le cas de l’Allemagne nous semble intéressant pour faire progresser toutes les parties prenantes. Notre expérience nous montre que la qualité de service a progressé avec une augmentation du trafic et allégement de la charge des collectivités. Sur le plan social le transfert de personnel s’est fait sur la base du volontariat avec un processus adaptatif. La Deutsche Bahn elle-même s’est mise à travailler différemment.
VR&T. Etes-vous satisfait de la possibilité d’accéder aux ateliers de maintenance de la SNCF ?
F. G. Il faut tout d’abord souligner que nous avons la capacité d’assurer nous-même la maintenance qui touche à notre cœur de métier. Cela dit notre attitude est pragmatique et à la recherche de la meilleure efficacité au bénéfice du service public. Nous sommes prêts à recourir aux services et aux compétences de la SNCF. Si les installations de la SNCF sont accessibles et efficaces, pourquoi s’en priver ? Cela suppose un contrat avec l’opérateur historique.
Il faut savoir que l’accès aux ateliers de maintenance est défini dans le document de référence du réseau. Dans sa version actuelle, ce document ne répond pas aux nécessités de service des nouveaux entrants. Chaque année, ce document doit être rediscuté. Nous profiterons de ces discussions pour mettre en avant nos attentes.
VR&T. Faut-il que les régions deviennent propriétaires du matériel roulant ?
F. G. C’est logique. C’est devenu, sur le principe, un non-sujet pour la SNCF. Il reste à modifier les textes du point de vue juridique.
VR&T. Que pensez-vous de la solution recommandée pour la distribution des billets ?
F. G. Les canaux de distribution des billets représentent un système évolutif. Nous sommes convaincus que les solutions de distribution sont « multicanaux ». C’est le cas aujourd’hui dans les réseaux urbains. Les réseaux vendent leurs titres chez leurs dépositaires, dont la SNCF par exemple. Comme la distribution est en train de se dématérialiser, on peut imaginer des modes combinés.
VR&T. Qu’attendent, selon vous, les régions de cette expérimentation ?
F. G. Notre sentiment est que les régions attendent des garanties de qualité de service et une offre commerciale intégrant de nombreux paramètres : l’attention aux voyageurs, le service, l’accessibilité, la billetterie… Nous pensons aussi qu’elles attendent des coûts maîtrisés mais surtout plus de transparence. Par ailleurs, nous observons que les collectivités sont soumises à des contraintes financières durables. Le service ferroviaire étant coûteux, il s’agit donc d’offrir plus de service et de qualité pour le même prix. Cela dynamisera le trafic. Nous sommes convaincus que nous pourrons répondre aux attentes des régions en diminuant sensiblement la charge pour les collectivités locales tout en augmentant la qualité de service.
Propos recueillis par Marie-Hélène Poingt
Joachim Fried, directeur des affaires européennes de la Deutsche Bahn :
« Les préconisations restent trop timorées pour me satisfaire pleinement »
Ville, Rail & Transports. Comment jugez-vous le rapport du sénateur Grignon sur les conditions d’expérimentation de l’ouverture à la concurrence des trains régionaux de voyageurs en France ?
Joachim Fried. Je me réjouis tout d’abord que ce rapport paraisse enfin, après un long travail de réflexion dans le cadre duquel j’ai été auditionné. Très complet, le rapport constitue un outil remarquable pour la suite des travaux. J’attendais cependant que le rapport soit plus ambitieux dans ses recommandations et propose, outre une franche ouverture du marché, une refonte en profondeur du système ferroviaire français, dont je lis régulièrement dans la presse qu’il serait à bout de souffle. Or, les préconisations restent trop générales et timorées pour me satisfaire pleinement. Enfin, les « nouveaux entrants » sont présentés comme des start-up dont il faudrait s’assurer qu’elles n’altéreront pas la sécurité sur le réseau ferré français : après le « Ryantrain », voilà qu’on nous fait peur avec le « Bad-train » ! J’ai du mal à reconnaître sous ces traits une entreprise comme DB/Arriva, un des leaders mondiaux de la mobilité.
VR&T. La DB est-elle intéressée par l’exploitation de TER en France ?
J. F. La DB n’a jamais caché qu’elle souhaitait bénéficier pour sa filiale Arriva du même droit en France que ses concurrents en Allemagne. La réciprocité devrait être naturelle au sein de l’Union européenne tout entière : alors que 20 % des TER allemands sont aujourd’hui exploités par nos concurrents – dont les français Keolis (filiale de la SNCF) ou Veolia –, le TER français demeure fermé aux opérateurs autres que la SNCF.
Cela étant dit, j’attends de connaître les conditions d’exploitation des TER qui nous seront réservées en France avant de vous confirmer que nous prendrons part aux appels d’offres.
VR&T : Le rapport se prononce pour un socle social harmonisé qui s’applique à tous, salariés du privé et cheminots, après négociation avec les partenaires sociaux d’une convention collective. Qu’en pensez-vous ?
J. F. En créant la Deutsche Bahn AG, en 1994, l’État allemand souhaitait « dégraisser le mammouth » ferroviaire – pour citer une expression française. Ce n’est pas un hasard si le Parlement allemand a dans le même temps entièrement ouvert le marché ferroviaire. Bien qu’un régime de droit commun se soit substitué au statut des cheminots pour toutes les nouvelles embauches à la DB, il n’y a eu aucune harmonisation sociale. La plus grande flexibilité de nos concurrents a permis aux Länder (l’équivalent de vos régions) de réduire drastiquement les coûts du transport ferroviaire (-30 % en quinze ans). La DB a dû s’adapter : elle a triplé sa productivité (+240 %), s’est mise au niveau de ses concurrents et est devenue l’entreprise moderne et performante qu’elle est aujourd’hui. Ce n’est qu’alors, quinze plus tard, qu’une convergence des salaires et du temps de travail – mais pas de l’organisation du travail – a été engagée afin d’éviter que la concurrence ne porte primairement sur la hauteur des salaires. Mais une chose est claire : si l’on avait appliqué à l’ensemble des opérateurs à l’époque les équilibres propres à la DB, nous aurions manqué la chance qui nous était offerte de dynamiser notre branche.
VR&T. Etes-vous favorable au principe du transfert (sur la base du volontariat) de cheminots à l’opérateur ferroviaire qui remporterait un contrat ?
J. F. Deux règles primordiales doivent prévaloir sur l’automaticité d’un transfert : premièrement, un opérateur doit pouvoir choisir ses futurs employés parmi les femmes et les hommes qui souhaitent eux-mêmes travailler pour lui, aux conditions qu’il leur offre. Deuxièmement, il n’est jamais souhaitable de voir s’établir un système de « castes » au sein d’une équipe de collaborateurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la solution, également préconisée par le rapport, d’un détachement d’agents SNCF bénéficiant du statut de cheminot est parfaitement inadéquate. En Allemagne, la DB conserve ses salariés même en cas de perte d’un contrat régional et leur propose des solutions de reclassement. Ce système fonctionne très bien.
VR&T. Que pensez-vous de la solution retenue par le rapport en ce qui concerne la maintenance (l’accès aux ateliers de la SNCF) ? Cela vous paraît-il réalisable ? Ne craignez-vous pas des coûts ou une organisation du mode de production différents (trop cher, pas assez souple, par exemple) de ce que vous pourriez souhaiter ?
J. F. La maintenance est un élément essentiel du schéma de production d’un service ferroviaire, avec un impact direct sur la qualité du service à l’usager. C’est pourquoi la plupart des opérateurs en Allemagne ont bâti leurs propres ateliers. A terme, il en sera de même en France, à condition que la durée des conventions permette d’amortir l’investissement. Dans l’intervalle, l’accès aux centres de maintenance SNCF doit être assuré sur une base transparente et non discriminatoire, agrémentée des garanties contractuelles nécessaires. Ceci me semble être réalisable, d’autant plus que nous pouvons désormais compter sur l’Autorité de régulation pour clarifier les litiges.
VR&T. Les régions attendent de la concurrence une baisse des coûts, plus de transparence, un service de meilleure qualité. Que pensez-vous pouvoir leur apporter et comment ?
J. F. DB/Arriva, ce sont 78 500 collaborateurs qui transportent avec succès quelque 2 milliards de passagers par an dans toute l’Europe et sur des marchés très compétitifs comme en Allemagne. Nous comptons mettre cette expérience au profit des régions. Mais pour pouvoir tirer bénéfice de la concurrence, ces dernières doivent s’engager résolument sur la voie de l’ouverture, aller au-devant des opérateurs et leur faire confiance. C’est ensemble que nous définirons des services offrant les plus grands bénéfices en termes de qualité et d’innovation. Les AOT allemandes ont d’abord cherché à tout imposer, reléguant les opérateurs au rang de prestataires tractionnaires. Aujourd’hui, les AOT ont compris qu’elles gagneraient plus en homogénéisant leurs cahiers des charges et en laissant plus de marge de manœuvre aux opérateurs. Et tout le monde s’en félicite.
Propos recueillis par Marie-Hélène Poingt