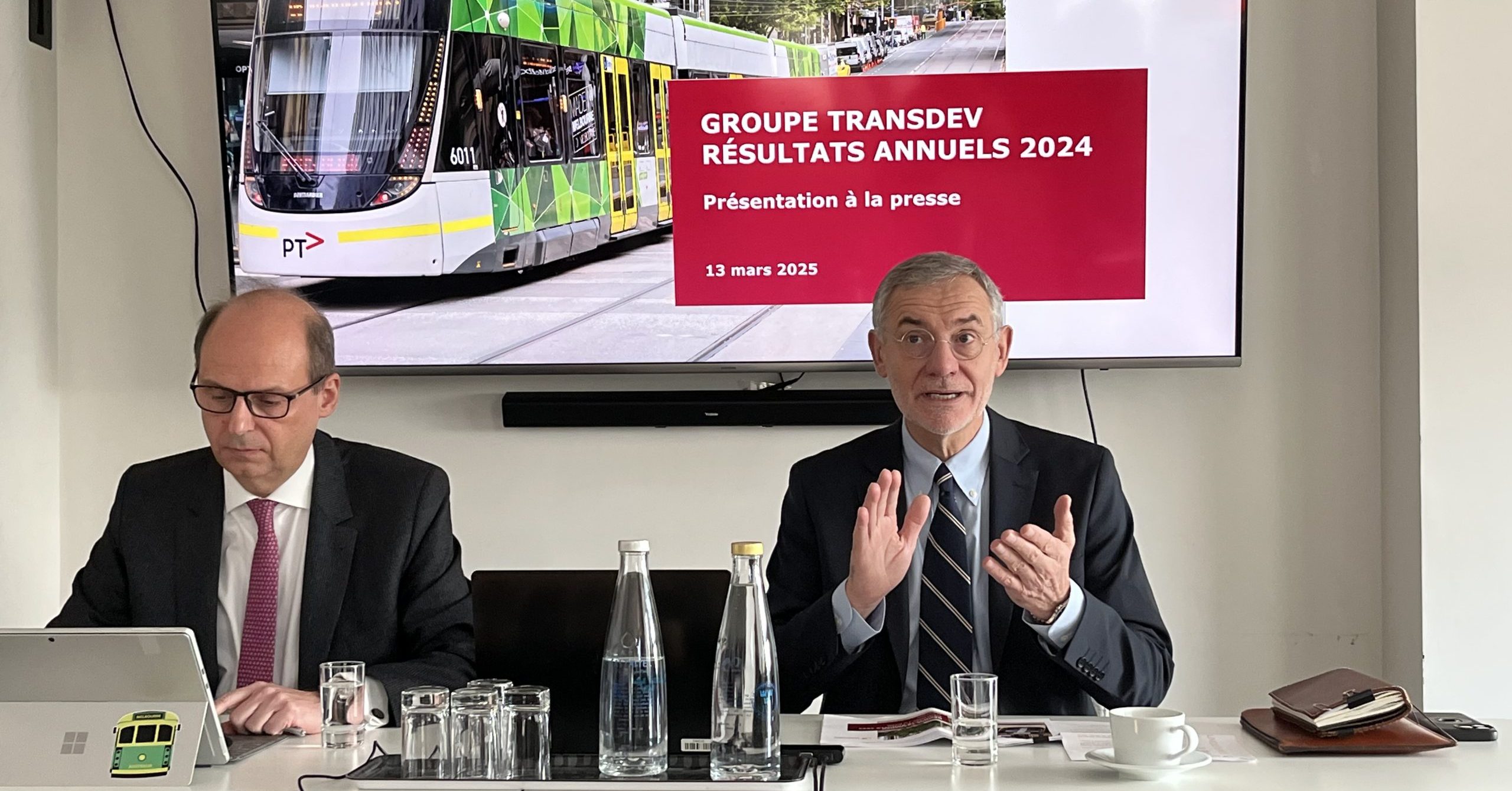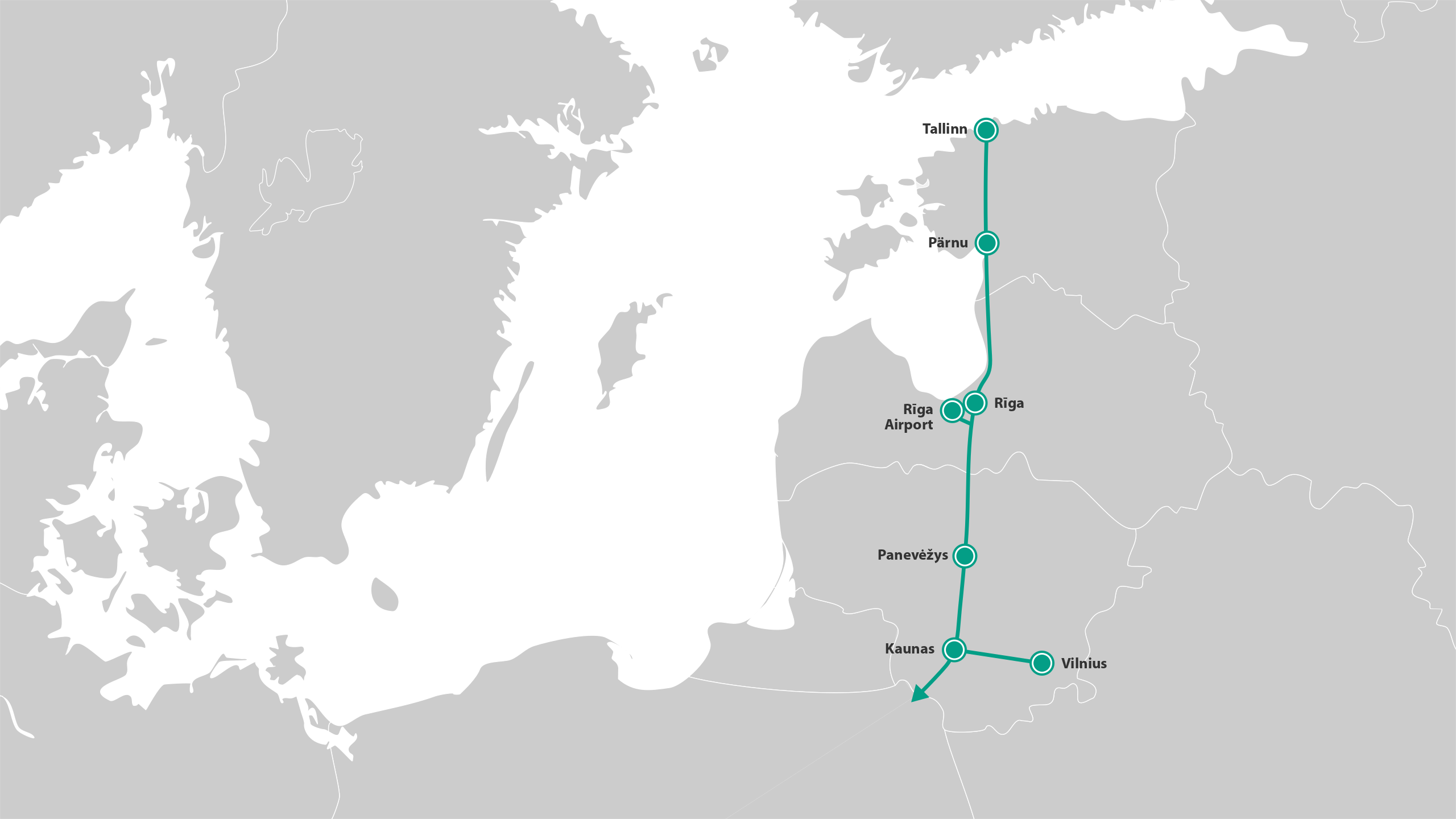Soixante-sept ans après sa destruction par les bombardements alliés, la ligne construite par l’armée japonaise au plus fort de l’épisode asiatique de la Seconde Guerre mondiale, qui reliait ce qu’on appelait encore la Birmanie à la Thaïlande, pourrait renaître de ses cendres. Un projet qui se lit à travers le prisme d’une toute récente ouverture politique, aussi fragile qu’insuffisante, mais source d’espoirs dans ce pays dirigé par l’un des régimes les plus isolés et les plus liberticides de la planète.
Aung Min, le ministre des chemins de fer du Myanmar, l’a déclaré à l’AFP fin mai : une étude de faisabilité serait lancée en octobre pour la réhabilitation de 105 km de l’ancien Chemin de fer de la mort, une ligne construite par le Japon entre la Thaïlande et la Birmanie pour l’approvisionnement de son armée lors du dernier conflit mondial. « Nous allons rouvrir cette voie. D’autres pays ont dit qu’ils nous aideraient et nous allons continuer à y travailler. Nous ferons des études et tenterons de lancer le chantier avant la saison des pluies, avec l’aide de la communauté internationale », a-t-il ajouté. Il a également insisté sur les retombées économiques potentielles pour les communautés qui vivent à proximité du col des Trois Pagodes, qui marque la frontière entre les deux pays.
Le projet est complexe. En plus des difficultés liées au terrain et à la météo, il existe des problèmes liés aux expropriations et aux droits des minorités ethniques, notamment des Karens, qui, dans le sud du Myanmar, sont en conflit ouvert avec l’armée birmane. Ce groupe ethnique chrétien qui compte en 4 et 5 millions d’individus est entré dans la lutte armée en 1948, quelques mois à peine après l’indépendance.
À noter qu’Aung Min, le ministre des Chemins de fer, est également un des négociateurs des pourparlers de paix entre le régime et la rébellion et qu’il a annoncé le projet de réouverture de la ligne à l’occasion de l’inauguration d’un bureau de liaison de la Karen National Union (KNU), le principal mouvement armé d’opposition, qui vient d’ouvrir sur le col des Trois Pagodes. Un cadre du régime devant un parterre d’officiels et de dirigeants de la guérilla Karen : la scène était encore inimaginable, il y a seulement quelques mois.
Justement, la paix est la condition sine qua non de la reconstruction de la ligne. Depuis l’indépendance en 1948, l’État a toujours été en conflit avec les nombreux groupes ethniques minoritaires, présents essentiellement dans les régions frontalières. Ces mouvements armés ont bénéficié de l’éloignement d’un pouvoir central qui n’a su jusqu’alors qu’opposer la force à ces velléités d’autodétermination. Le projet ferroviaire et cette volonté de créer du développement marquent bien un tournant dans les relations entre le régime et ces groupes ethniques.
Un train pour rompre l’isolement
Aujourd’hui, le Myanmar est l’un des pays les plus fermés du monde. Il est impossible de rejoindre la plus grande ville du pays, Yangon, autrement qu’en prenant l’avion, à moins de passer par la Chine, l’encombrant voisin et indispensable soutien du régime. Les autorités birmanes ont d’ailleurs lancé en 2009 le projet d’une liaison ferroviaire entre Lashio, dans l’ouest du Myanmar, et Jiego en Chine. Les Chinois, qui cherchent un débouché sur le golfe du Bengale, ont d’ailleurs en grande partie financé le projet. Les travaux ont commencé en 2011.
Cet isolement s’explique notamment par la présence de groupes armés dont nous venons de parler dans de nombreuses régions birmanes, mais pas seulement. Il a également permis aux militaires au pouvoir d’asseoir un peu plus leur autorité. La toute nouvelle volonté d’ouverture correspond à deux réalités distinctes. Tout d’abord, le désir d’une partie de l’armée de freiner la satellisation du pays à son puissant voisin chinois en s’ouvrant vers d’autres sphères d’influences, notamment la Thaïlande. On a également pu observer ces dernières semaines une certaine libéralisation politique. Les Birmans ont obtenu la liberté de manifester, comme dernièrement à Mandalay, dans le nord du pays. La communauté internationale a aussi salué la fin du régime de résidence surveillée qui touchait Aung San Suu Kyi, la dirigeante de l’opposition démocratique, ainsi que la participation de son parti aux premières élections libres depuis 1988. Libéralisation encore balbutiante… Les élections ne permettaient de conquérir que 45 sièges sur les 664 que compte le parlement qui siège à Nay Pyi Taw, la nouvelle capitale. Mais la stratégie de ce régime orwellien semble bel et bien avoir changé.
Un projet synonyme d’opportunités économiques
Ce projet de réouverture du Chemin de fer de la mort participe à ce mouvement. À terme, les touristes, très nombreux en Thaïlande, pourraient enfin visiter le Myanmar en y entrant par le train. Le potentiel touristique du pays est immense : le site de Bagad, inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité, le lac Inné et ses temples lacustres ou la cité royale de Mandalay, le Myanmar a beaucoup à offrir. Les autorités espèrent accueillir 1,7 million de touristes en 2012, soit près du double de l’année précédente. Cette nouvelle liaison ferroviaire permettrait de voir ce nombre grossir encore.
En dépit de ses importantes ressources naturelles, le Myanmar est un pays extrêmement pauvre. La captation des richesses nationales par les militaires, ainsi que les sanctions prises par une grande partie de la communauté internationale ont laissé l’économie exsangue. L’évolution récente de la politique birmane devrait changer la donne. L’Union européenne a notamment déclaré qu’elle étudiait un allégement des sanctions. Le tourisme est un secteur dont les bénéfices sont parmi les mieux partagés dans un pays où une « nomenklatura » issue de l’armée accapare la grande majorité de la richesse nationale. A fortiori dans cette région traumatisée par plus de 60 ans de guerre civile, par de multiples massacres et des déplacements de populations massifs, notamment dans les camps de réfugiés de l’autre côté de la frontière, ce projet ferroviaire semble le meilleur moyen d’installer durablement la paix. Les autorités birmanes ont également le projet d’ouvrir une zone économique spéciale dans cette région, afin d’attirer les investissements étrangers notamment en provenance de Thaïlande. Du côté thaïlandais aussi, la majeure partie de la ligne a été détruite.
Il n’en subsiste aujourd’hui qu’une petite section dans la province de Kanchanaburi, utilisée pour la circulation d’un train touristique. La Thaïlande serait d’ailleurs très intéressée par la réouverture de cet axe ferroviaire. Les milieux d’affaires y suivent en effet avec intérêt l’évolution de la situation au Myanmar. Le royaume thaïlandais est d’ailleurs déjà le troisième partenaire économique du pays, après la Chine et Singapour. Les Britanniques l’avaient compris, tout comme les Japonais, le Myanmar occupe une position de carrefour essentiel entre trois grands espaces économiques, politiques et culturels : la Chine, le sous-continent Indien et l’Asie du Sud-Est. Des infrastructures de transports modernes et efficaces permettraient à l’économie du pays de profiter de cette position géographique. La liaison entre Yangon et Bangkok pourrait bien être la première d’un tel réseau. Et elle aidera peut-être le peuple birman à progresser sur le chemin de la démocratie et de jouir enfin des libertés les plus essentielles.
Samuel DELZIANI – Photos : © Fredskitchen
Birmanie ou Myanmar ?
En Occident, nous utilisons souvent le mot Birmanie pour qualifier ce pays d’Asie du Sud-Est. Ce nom est un héritage du passé colonial du pays, que les Britanniques ont colonisé jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. La junte militaire au pouvoir a décidé dans un élan nationaliste de revenir aux noms birmans des lieux. Ainsi, la Birmanie est redevenue le Myanmar. Rangoon, la plus grande ville du pays, est redevenue Yangon. Cette « birmanisation » de la toponymie est maintenant reprise par l’ensemble des organisations internationales, nous avons donc choisi d’utiliser également ces noms.