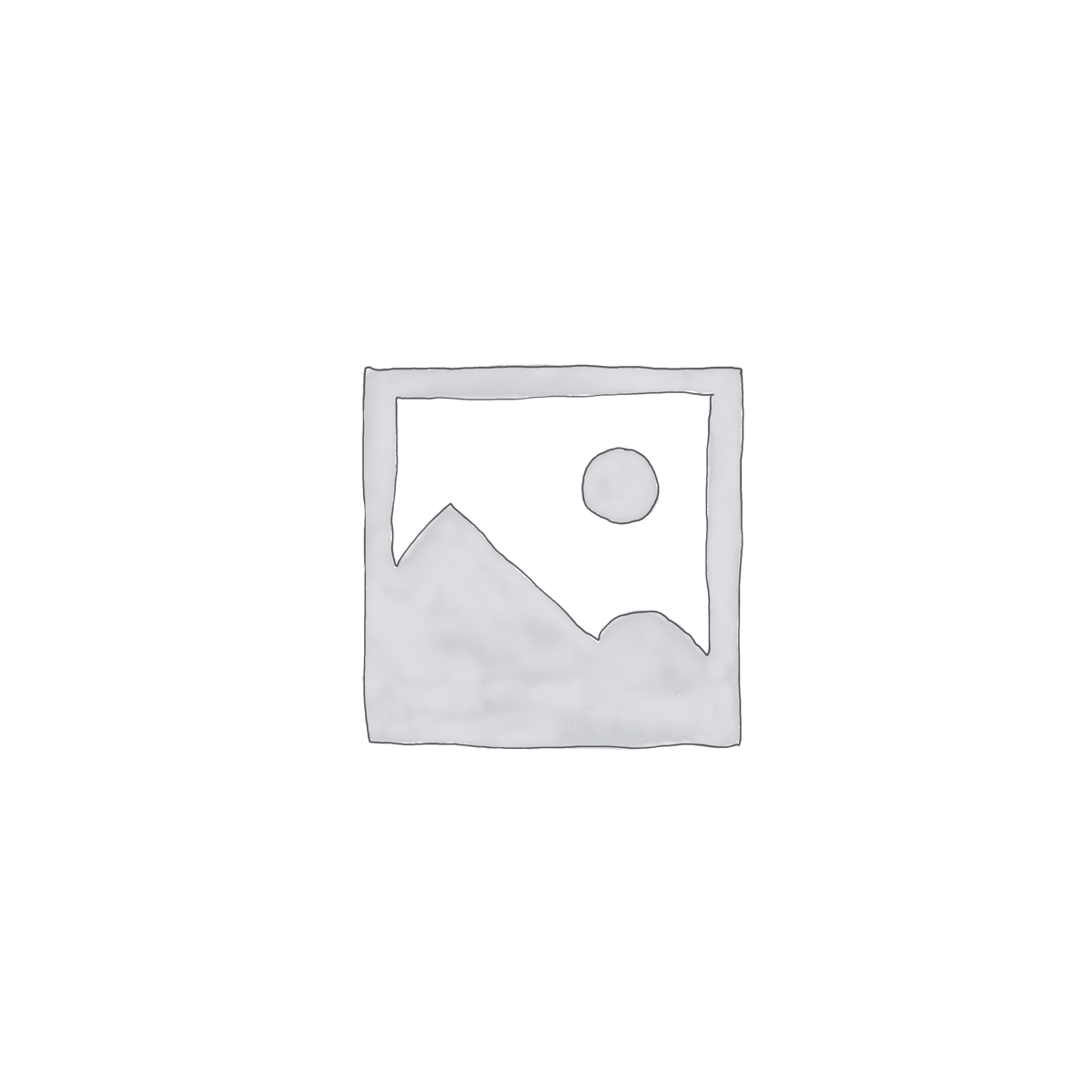La Vie du Rail. En parlant de Saint-Lazare, vous évoquez un chantier emblématique de ce que la SNCF veut faire. En quoi ce modèle doit-il faire école ?
Sophie Boissard. Il est exemplaire par sa dimension technique, par la qualité de la réhabilitation d’un monument historique qui est une grande réussite architecturale. On lui a redonné son lustre historique et on a exhumé les verres peints de Sarteur, absolument magnifiques, au niveau du quai transversal. Exemplaire également par la création d’un pôle d’échanges fonctionnel du XXIe siècle dans un bâtiment du XIXe, avec le travail fait sur la signalétique, la simplicité des accès à la rue, la simplicité d’accès au métro. Ce projet est encore exemplaire de ce que l’on peut faire en termes de financement.
LVDR. Le principal intérêt de ce type d’opération, est-ce de vous permettre de financer ce que le groupe SNCF n’aurait absolument pas les moyens de faire ?
S. B. C’est clair, nos moyens en fonds propres sont limités, notamment en raison des contraintes d’endettement de la SNCF. Seuls, nous n’aurions pas pu
investir 250 millions d’euros dans la rénovation de
Saint-Lazare. Klépierre met 160 millions, nous, 90 millions sur nos fonds propres. A titre de comparaison, le budget annuel que nous investissons sur fonds propres hors Ile-de-France est de 170 millions d’euros. 90 millions, c’est la moitié du budget annuel investi dans les gares ! Et puis, ce partenariat permet aussi de croiser les compétences. Nos partenaires nous apprennent à revisiter nos espaces, à sortir de nos schémas. Sans eux, nous n’aurions pas su regarder et réutiliser l’ensemble de ces surfaces.
LVDR. Comment conjuguer les ambitions en termes de patrimoine et de services ?
S. B. Il y a, par exemple, le choix des couleurs, très en accord avec les verres peints. Nous avons été draconiens dans la charte de marques, très épurée, y compris pour la signalétique commerciale de grande qualité. Cela met en valeur le bâtiment plus que cela ne l’étouffe. Et puis, c’était historiquement une gare Grandes Lignes, de prestige, avec toutes les fonctionnalités d’une gare de voyages au long cours. Aujourd’hui, c’est par excellence, en Ile-de-France et avec la Normandie, la gare des pendulaires. Les espaces étaient dimensionnés pour la gare d’hier, alors qu’elle accueille une grande quantité de voyageurs. Il fallait réinventer. Entre les personnes pressées de la semaine et celles qui flânent avant leur week-end, chacun a son mot à dire. Nous n’imposons rien, nous proposons. Saint-Lazare a besoin de cette multifonctionnalité.
LVDR. La commercialisation des espaces en gare, est-ce un métier que vous ne savez pas faire puisque vous le déléguez ?
S. B. Nous ne le déléguons pas complètement. Dans la convention avec Klépierre, on s’est mis d’accord sur le type de services et de commerces et, pour le choix des enseignes, nous avons travaillé en étroite collaboration. Nous ne sommes pas un opérateur de centre commercial mais une gare n’est pas un centre commercial. Nous avons à construire ensemble un modèle adapté à ces hyper-centres-villes que sont les grandes gares.
LVDR. Dans ce type de partenariat, y a-t-il un risque de cannibalisation progressive de la SNCF par le privé ?
S. B. Il n’y a pas de cannibalisation car nous restons maîtres du domaine public ferroviaire. Nous demandons à l’occupant d’avoir des activités compatibles avec les missions principales d’une gare et de générer des flux de revenus qui participent au coût économique du service de transport. Actuellement, les revenus qui remontent des gares parisiennes servent d’ailleurs à financer les investissements en gare sur l’ensemble du réseau. Il n’y a donc pas cannibalisation si l’on trouve un juste équilibre entre les services et commerces et la fonction première des gares qui est d’être un lieu d’échanges et de transports.
LVDR. Quels sont les prochains grands défis de ce type pour vous à Paris ? Austerlitz ? Montparnasse ?
S. B. A Montparnasse, Il est grand temps de « ranger » la gare et de revisiter les circulations depuis le métro. Le trafic ne cesse de croître. Nous faisons un cahier des charges puis ouvrirons un dialogue compétitif pour voir ce que des partenaires nous proposent pour faire évoluer l’espace. L’objectif
est d’avoir une première tranche significative achevée en 2017.
Aussitôt après, sur la liste, Austerlitz. Le montage est très compliqué car c’est un programme immobilier tout autant que de rénovation
de gare. Nous avons une convention avec la Ville de Paris et son aménageur, la Semapa, qui prévoit trois choses. Un, une piétonnisation et une remise à neuf de la façade de l’embarcadère sur la Seine. C’est engagé et doit être livré en 2014. On reconfigure complètement le parvis, avec ouverture sur les nouvelles voies potentiellement TGV construites sous la dalle, création d’un escalier reliant le parvis à l’avenue de France, d’un autre reliant le parvis à la Seine, et « verdissement » du parvis.
Deuxième temps, on va s’attaquer à l’intérieur de la halle. On va couvrir le RER C qui émerge au bout de la halle, enlever le parking, créer des bureaux à l’intérieur de la halle. Nous allons chercher un partenaire pour définir avec lui ce qu’on peut faire de ce volume extraordinaire qu’est la halle historique, qui ne sert plus pour le train.
Dans le même temps, on va travailler sur la partie qui va jusqu’à l’hôpital de la Salpêtrière et au Muséum, en copropriété avec la Ville de Paris et la Semapa. 100 000 m2 vont sortir de terre, de logements, équipements publics, espaces tertiaires, espaces pour la gare, dont, globalement, 20 000 m2 de commerce. C’est un quartier qui va voir le jour. Ce grand projet de ville autour d’un nœud de transport va prendre une bonne dizaine d’années.
LVDR. Y a-t-il dans ces nouvelles idées certains commerces qui marchent bien et d’autres pas ?
S. B. Ce que les gens attendent avant tout, c’est de la restauration et des concepts centrés sur le quotidien sous ses différentes formes. Un concept comme food-court – avoir dans un même lieu différents types de restauration rapide –, tout ce qui est achat du quotidien aussi. La santé aussi est un secteur qui marche très bien, comme on le voit avec la pharmacie de la gare de l’Est, qui est un lieu magnifique. Il ne faut pas de lieux encombrés dans lesquels on peut à peine circuler. Les espaces doivent être vastes et faciles pour déambuler avec sa valise…
Mon sentiment, c’est qu’on part d’assez loin et que, par rapport à la fréquentation des gares, au mode de vie urbain, à ce que font d’autres pays autour de nous, on ne souffre pas d’un excessif remplissage des gares
par des commerces – au contraire ! L’essentiel dans les années qui viennent va être de rester juste et de montrer au voyageur qu’on ne le prend pas pour une vache à lait. On doit être dans les mêmes prix que ce qu’on pratique dans le quartier. Il n’y a pas de « taxe gare ».
LVDR. Vous êtes-vous inspirée de pays voisins ?
S. B. Les Espagnols sont partis sur un modèle de centres commerciaux de 30 000 à 40 000 m2 pour leurs gares TGV. Du fait de la violence de la crise dans le pays, je pense que ces programmes ne verront pas le jour. C’est un modèle très éloigné de la conception qu’on se fait en France d’une gare comme lieu public, lieu aéré, lieu urbain.
A l’inverse, voyez la Suisse. La gare de Zurich est le troisième centre commercial du pays… et cela ne se voit pas. Ils ont par exemple densifié les commerces au niveau du sous-sol, C’est un très bon modèle à suivre. C’est un peu la même chose à Bâle. Mais c’est en Suisse, et avec les moyens financiers de la Suisse… Les Allemands ont à peu près la même inspiration. Leurs gares marchent très bien pour prendre le train, le tram ou le métro, et elles sont très animées. Le point principal pour moi, c’est l’animation.
Je trouve assez intéressant de pouvoir à partir des gares contribuer à la révolution des pratiques de consommation. Rompre avec l’âge des horribles entrées de ville, leurs zones de très grande surface, et l’affichage qui va avec, où l’on ne peut aller qu’en voiture. Qu’on en revienne à une réflexion sur les centres-villes et les commerces de proximité, cela me semble salutaire. Il y a un enjeu de politique publique. Quand j’entends parler de marchandisation des gares, c’est presque à rebours de ce que nous faisons.
Propos recueillis par François Dumont et Pascal Grassart